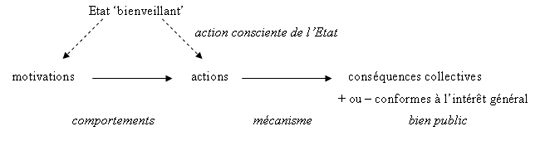Introduction : Les récits économiques comme contes d’anticipation
Les économistes parlent rarement de la portée politique de leur science, et la lettre de Walras dont nous nous sommes servis en introduction constitue à cet égard, une exception. Les principes économistes sont le plus souvent illustrés sous forme de récits.
A cet égard, la « fable des abeilles » de Bernard de Mandeville (1714) si elle n’est pas un modèle d’analyse économique, peut être considérée comme le modèle fondateur du récit économique au sens ou nous l’entendons. Il est certain que cette fable a pour cadre l’état de nature, et non la cité bien administrée où se situent la plupart des récits économiques, et notamment ceux de Walras. Néanmoins, si le cadre est différent, le déroulement des évènements est le même.
La logique du récit économique n’a en effet pas changée depuis trois siècles, malgré les progrès de l’analyse et de la formalisation mathématique, et malgré la variété croissante des préoccupations des économistes. Depuis Mandeville, les économistes racontent comment des individus qui ne se préoccupe que de leur intérêt privé (ou de l’intérêt privé d’autrui, s’ils sont altruistes) réalisent, avec plus ou moins de bonheur, l’intérêt général.
L’économiste/écrivain, dispose, pour conduire ses agents privés au bien public, de plusieurs outils.
- Les comportements des agents qui, tout en respectant l’attitude de non-souveraineté, peuvent être très divers, et plus ou moins bien adaptés à la réalisation du bien public. Par exemple, chez Mandeville, c’est le goût « vicieux » pour le luxe chez les (riches) consommateurs, qui résume la ‘bonne’ fonction d’utilité : celle dont les conséquences collectives sont les plus heureuses. Le goût des capitalistes classiques pour l’accumulation des capitaux, ou la modération des épargnants néoclassiques dans leur préférence pour le présent, sont d’autres dispositions heureuses, qui permettent d’atteindre le meilleur « score », dans l’unité choisie pour mesurer le bien public.
- Les procédures, conventions, mécanismes… par lesquels les agents interagissent, sont également fort importants : le libre échange vaut mieux que l’autarcie, la négociation décentralisée vaut mieux que la négociation centralisée (ou l’inverse), le jeu répété vaut mieux que le jeu unique. De nouveau, la « bonne » manière de faire, est celle qui permet le mieux de réaliser le bien public.
- L’économiste/écrivain se donne en outre le plus souvent, le droit à un « joker » en la personne de l’Etat. Après Mandeville, et surtout à partir de Walras, les agents sortent de l’état de nature, et l’Etat va encourager, promouvoir, organiser, les meilleurs comportements et les meilleurs mécanismes, et mettre à l’écart les moins efficaces, les moins justes…
Les économistes apparaissent donc à ce stade, comme les participants à un jeu littéraire, ou ils doivent écrire des fictions, tout en respectant une « contrainte d’écriture ». Cette contrainte consiste à faire réaliser le bien public par ses personnages, sans que ceux ci le recherchent. Les contraintes d’écriture, tout en étant rares, ne sont pas exceptionnelles en littérature. Parmi les exemples célèbres, on peut citer « Le baron perché » d’Italo Calvino (contrainte narrative), les bien nommés « exercices de style » de Raymond Queneau (contrainte stylistique) ou « La disparition » de Georges Perec (contrainte, disons, typographique). La contrainte que se donnent les économistes est évidemment narrative. De même que dans « Le baron perché » Calvino s’impose de faire parvenir (fictivement) un individu à l’âge adulte, sans que jamais il ne quitte les arbres, les économistes s’imposent de faire parvenir leurs personnages au bien public, sans que jamais ils n’y pensent.
A première vue, le succès n’est pas garanti. On voit bien, intuitivement, que si, par exemple, l’écrivain veut faire gravir une montagne à ses personnages, il est imprudent d’imaginer que le but de chacun d’eux est de se diriger vers la mer. Autrement dit, la démonstration du fait que les individus peuvent « spontanément » parvenir au bien public par le seul jeu de leurs interactions aveugles, est un travail non seulement difficile, mais qui va même à l’encontre d’un certain sens commun.
De plus, le caractère académique du récit économique, occasionne des difficultés supplémentaires :
Il s’agit d’abord de respecter la ‘rationalité des agents’ (pas trop d’illusion monétaire ou d’anticipations adaptatives).
Il s’agit surtout de respecter la logique hypothético-déductive, qui permet aux textes économiques d’être aussi des textes scientifiques.
Les récits économiques sont donc des ‘histoires’, mais des histoires rigoureuses.
Maintenant ces ‘histoires’, comment les étudier ? Comme elles ‘racontent’ toujours la même chose (comment des individus réalisent le bien public sans l’avoir cherché), on peut les considérer comme faisant partie d’un même corpus de récits.
Pour les étudier, on va donc s’inspirer d’un autre corpus : celui des contes populaires russes rassemblés et commentés par le folkloriste Wladimir Propp.
Le principal ouvrage de cet auteur : « Morphologie du conte populaire russe » (1928), est à l’origine d’une grille d’analyse des textes littéraires, dite « formaliste ». Propp y prend comme unité d’étude, les contes « merveilleux », c’est-à-dire les contes de fées, récits dans lesquels un ou des éléments magiques ou surnaturels apparaissent ( fées, sorts, objets animés...). Il entreprend de les classer et, pour se faire, il dégage dans ces récits des régularités narratives qu’il appelle « fonctions ». Les « fonctions » de Propp sont les prédécesseurs des célèbres ‘mythèmes’ de l’ethnologue Claude Lévi-Strauss, qui s’en inspirera, tout en rejetant leur caractère narratif et non lexical (Lévi-Strauss 1960).
Résumons le propos de Wladimir Propp.
Lors qu’on lit une série de contes merveilleux russes, on aperçoit plusieurs régularités.
Les mêmes épisodes se retrouvent souvent d’un conte à l’autre, avec des protagonistes et un décor nominalement différents. Ces éléments narratifs simples (les fonctions), sont les unités de base du conte. Exemples : F.XI : le héros quitte sa maison ; FXII : le héros subit une épreuve, FXIII : un objet magique est remis au héros.
Chaque conte met en scène ces épisodes avec son imagination propre (le héros peut être un prince, un paysan, une fille cadette...) et les agence dans un ordre qui lui est également propre (chaque conte n’est construit qu’avec une partie des « fonctions » à sa disposition).
Mais pour des raisons de cohérence narrative, les permutations et les mises à l’écart de ‘fonctions’, sont limitées. Par exemple, F.XI précède toujours F.XII, c’est-à-dire que, par exemple, le héros quitte toujours sa maison avant de subir l’épreuve (s’il en subit une).
Propp aboutit ainsi à une série de contes canoniques, et montre que leur diversité n’est qu’apparente : elle se ramène, pour l’essentiel, à, disons, des changements de décor.
« Nous pouvons dire en anticipant que les fonctions sont extrêmement peu nombreuses, alors que les personnages sont extrêmement nombreux. C’est ce qui explique le double aspect du conte merveilleux : d’une part son extraordinaire diversité, son pittoresque haut en couleurs, et d’autre part, son uniformité non moins extraordinaire, sa monotonie »(p30)
[Par exemple] : « Comparons entre eux, les cas suivants :
1 : Le roi donne un aigle à un brave. L’aigle emporte le brave dans un autre royaume
2 : Le grand-père donne un cheval à Soutchenko. Le cheval emporte Soutchenko dans un autre royaume.
3° : Un magicien donne une barque à Ivan. La barque emporte Ivan dans un autre royaume
... etc.
Ce qui change, ce sont les noms, et en même temps les attributs. Ce qui ne change pas, ce sont les actions... (Propp 1965 [1925] pp 28-29)
La variété colorée des contes populaires russe cache donc une grande monotonie. Pour Propp, la raison est culturelle. Ces contes s’alimentent aux sources de la même mythologie russe (de nouveau, cette idée sera reprise par Levi-Strauss, à propos de la mythologie des amérindiens).
Ce qui nous permet de transposer la méthode de Propp, aux modèles scientifiques qui forment la littérature économique, c’est que ces modèles s’alimentent, eux aussi, aux sources des mêmes valeurs, partagées par leurs auteurs. On pourrait d’ailleurs en dire autant des récits socialistes et des récits libéraux, que l’on pourrait ‘lire’ de la même manière. Notre travail consistera donc à donner une lecture ‘formaliste’ des récits économiques, non pas pour dénier à ces textes leur caractère scientifique, mais pour montrer que, au-delà de leur foisonnante variété, les théories économiques ‘brodent’ sur un même motif, et que c’est donc à ce niveau que se situe le débat.
Néanmoins, en ce qui concerne les récits économiques, on ne peut que s’inspirer de la méthode de Propp et non la reproduire, pour deux raisons :
- D’abord, parce que les récits économiques sont encore beaucoup moins variés (formellement parlant) que les contes merveilleux (Propp distingue 31 fonctions) Il s’agit toujours d’aller de l’insouciance du bien public au bien public, ou de décrire selon la formule de Hayek (qu’il dit reprendre de Ferguson) « les résultats des actions des hommes mais non de leurs desseins » (1953p57). Il y aura donc moins de ‘fonctions’ ou d’éléments à rechercher, et plus de variations à décrire.
- Ensuite, et surtout, parce que les récits économiques ne sont pas merveilleux et que leurs personnages ne peuvent donc pas compter sur l’intervention du surnaturel. Ainsi, pour prendre l’exemple le plus célèbre, il ne serait pas valable, dans un récit économique, de dire qu’une main invisible permet que les particuliers qui ne cherchent qu’à placer leurs capitaux de la manière la plus rentable, les répartissent ainsi de la manière la plus favorable au bien public. Il est nécessaire de dire, comme le fait Adam Smith, que tout se passe comme si une main invisible... et de décrire le mécanisme. On essaiera de montrer que cette nécessité scientifique est même la plus grande difficulté qui attend l’économiste qui veut respecter la contrainte d’écriture qu’il s’est fixée.
S1 : L’héritage de Mandeville
On va maintenant appliquer la lecture « formaliste » à la « Fable des abeilles », et distinguer de quels éléments ce récit se compose. Puis, on vérifiera que les mêmes éléments se retrouvent dans les modèles économiques plus récents.
Mandeville et La Fontaine
C’est en 1705 que Bernard Mandeville a publié pour la première fois à Londres :
« La fable des abeilles ou les vices privés font le bien public »
Dès la seconde édition de 1714, Mandeville accompagne sa fable de commentaires et de notes qui en explicitent le propos. Il l’introduit notamment ainsi :
« Cette satire cherche à montrer... de quels vils ingrédients réunis se compose cette saine mixture qu’est une société bien ordonnée. Ceci afin de faire ressortir la merveilleuse puissance de la sagesse politique qui a su édifier une si belle machine à partir des portions les plus viles » (Mandeville 1985 [1714] p24)
Rappelons brièvement les événements qui se succèdent dans cette fable d’une douzaine de pages :
Une ruche connaît l’opulence grâce aux vices des « abeilles » humaines qui la peuplent : les querelles donnent du travail aux avocats, les vols aux serruriers, la coquetterie aux drapiers... Quant à la malhonnêteté des avocats, serruriers, drapiers... eux-mêmes, elle leur permet, en gonflant artificiellement la demande qui s’adresse à eux, de multiplier leurs bénéfices et leurs effectifs. Pourtant, ces mêmes abeilles ne cessent de maudire les vices qui font leur opulence.
Dans un second temps, las d’entendre ces récriminations, Jupiter en colère les débarrasse de leur malhonnêteté. Chacun alors devient honnête et droit. Chaque profession décline alors par manque de clients et d’employeurs. La ruche se vide peu à peu de ses habitants, poussés au départ par la misère. Enfin, les survivants, décimés par les armées ennemies, doivent partir à leur tour.
La première publication de Mandeville avait été en 1703, la traduction de 27 fables de La Fontaine, auxquelles il avait ajouté 2 fables de son invention, « Some fables after the easie and familiar method of Monsieur de la Fontaine ». La « Fable des abeilles », elle-même doit beaucoup, dans sa construction, à celles de la Fontaine, au point que, compte non tenu de son contenu politique et de sa longueur, elle pourrait presque passer pour un nouveau pastiche. On y reconnaît notamment l’influence de deux fables bien connues que l’on peut rappeler.
Dans « Le laboureur et ses enfants », les enfants du laboureur obtiennent un bien (une récolte abondante) tout en en cherchant un autre (un trésor), sur le conseil de leur père mourant. Cette bonne récolte est, d’une manière très hayekienne, la conséquence de leurs actions mais non de leurs intentions.
Dans « Les grenouilles qui demandent un roi » les grenouilles demandent à grands cris un souverain. Jupiter leur envoie un tyran.
L’art de Mandeville consiste à transposer l’ « effet de composition » de la première fable dans le cadre politique de la seconde. Il obtient ainsi une nouvelle fable dans laquelle les abeilles obtiennent un bien ( la prospérité) tout en recherchant autre chose (la satisfaction de leurs vices). Le paradoxe est renforcé grâce à la seconde partie de la fable : dès que les individus cherchent à agir consciemment en vue du bien public, celui ci au contraire n’est plus obtenu. Il peut alors en tirer une morale qui commence par ces mots :
« seuls les fous veulent rendre honnête une grande ruche » (p40)
Les éléments narratifs que l’on va identifier dans la fable de Mandeville, sont les mêmes que l’on aurait pu repérer dans les deux fables de la Fontaine.
Les 5 éléments narratifs de la « fable des abeilles »
les vices privés
Dans le bref commentaire intitulé « Recherches sur l’origine de la vertu morale» qui accompagne sa fable, Mandeville remet en cause les qualificatifs de vices et de vertus. Il explique que :
« les premiers rudiments de la morale » ont été « inventés pour permettre aux ambitieux de tirer profit ( des hommes ) et d’en gouverner le plus grand nombre » (p46).
« Il était donc de l’intérêt des plus méchants d’entre eux plus que d’aucun autre, de prôner le dévouement au bien public qui leur permettait de recueillir le fruit du travail et de l’abnégation des autres, et en même temps d’être plus tranquille pour laisser le cours libre à leurs appétits ; ils s’accordèrent donc avec les autres pouvoirs, pour appeler VICE tout ce que sans égard pour l’intérêt public, l’homme commet pour satisfaire un de ses appétits [...] Ils s’accordèrent pour donner le nom de VERTU, à toute action dans laquelle l’homme [... ] s’efforce de faire du bien aux autres, ou de vaincre ses passions par une ambition rationnelle d’être un homme de bien »p47 (majuscules de l’auteur, nos italiques). (p47)
On voit que la ‘vertu’ (ou soi disant telle pour Mandeville) est essentiellement le souci du bien public. Il s’agit de la vertu civique, la même qui anime, selon Montesquieu, les citoyens des « républiques ». Mais, utile pour Montesquieu, cette prétendue vertu mène au désastre pour Mandeville et elle est donc en fin de compte une calamité. Elle est également mauvaise par son origine même, et dans les notes par lesquelles Mandeville explique et défend sa fable ligne à ligne, il revient souvent sur l’idée que les « bons sentiments » ne sont que de la sensibilité à la flatterie recouverte d’hypocrisie.
Le ‘vice’ (ou soi disant tel pour Mandeville) est donc essentiellement l’insouciance de ce même bien public. Les vices que Mandeville cite dans sa fable ( l’orgueil, la cupidité, la prodigalité...) sont en quelque sorte les descendants de ce vice initial.
le bien public
Mandeville ne définit jamais clairement ce qu’est pour lui le bien public, mais sa fable en fournit quelques indications :
p 29, le début du texte évoque
« Une vaste ruche bien fournie d’abeilles, qui vivait dans le confort et le luxe » (p32)
d’autres passages précisent cette idée :
« ces foules faisaient sa prospérité » »
« Ils approvisionnaient la moitié de l’univers, mais avaient plus de travail qu’ils n’avaient d’ouvriers »
« les pauvres eux-mêmes vivaient mieux que les riches auparavant » p34
Le bien public est donc économique et matériel. La fin de la fable suggère que ce bien est également la paix extérieure, compte tenu du respect qu’inspire aux ennemis potentiels, une prospérité convertible en puissance militaire.
La fable contient également des éléments narratifs à l’image des ‘fonctions’ de Propp.
les comportements
Le début de la fable relate les faits et gestes des individus qui recherchent leurs avantages privés. Pour Mandeville, chacun tire autant de bénéfices qu’il peut de son ‘état’. On peut citer quelques lignes de la fable, par exemple celles consacrées aux prêtres.
« Parmi les nombreux prêtres de Jupiter
Payés pour attirer les bénédictions d’en haut
Un petit nombre avait de la science et de l’éloquence
Mais des milliers étaient pleins d’appétits et d’ignorance
Mais tous se faisaient accepter, pourvu qu’ils sachent cacher
Leur paresse, leur luxure, leur cupidité et leur orgueil
C’est pourquoi ils étaient aussi connus
Que les tailleurs pour leur amour du drap
Ou les marins [pour leur amour] de l’eau de vie (p31)
Mandeville décrit ainsi successivement les avocats, les médecins, les soldats et les ministres, assoiffés de luxe, et prêts à toutes les tromperies pour se procurer des biens de consommation.
Pour résumer ceci à la manière d’un manuel, on pourrait écrire :
la dépense est une fonction croissante du vice.
le mécanisme
Pour transformer ces beuveries et ces folles dépenses en résultat conforme au bien public, il faut un opérateur. Celui ci est donné en quelques lignes seulement :
« La source de tous les maux, la cupidité
Ce vice méchant, funeste, réprouvé
Etait asservi à la prodigalité, ce noble péché
Tandis que le luxe donnait du travail à un million de pauvres gens
Et l’odieux orgueil à un million d’autres.
L’envie elle-même, la vanité,
Etaient serviteurs de l’application industrieuse ;
Leur folie favorite,
L’inconstance dans les mets, les meubles, le vêtement
Ce vice bizarre et ridicule
Devenait le moteur même du commerce »(pp33, 34)
Il s’agit maintenant de comprendre comment les comportements décrits auparavant vont servir la prospérité. Le mécanisme en œuvre est bien sûr le pouvoir que possède la dépense en biens de consommation, de se transformer en emplois chez les fournisseurs de ces biens.
Pour résumer ceci à la manière d’un manuel, on pourrait écrire :
l’emploi est proportionnel à la dépense.
l’action consciente de l’Etat
Dans la fable elle-même, l’Etat n’a aucun rôle. Mais, dans son commentaire, Mandeville indique
: « Je montre que ce sont précisément ces vices, qu’un gouvernement adroit fait servir à la grandeur et au bonheur terrestre du tout » (p88)
Il suggère donc que l’Etat doit intervenir de quelque manière, pour transformer les vices privés en vertu publique . On voit d’ailleurs ici la connexion assez étroite entre l’Etat et l’écrivain/moraliste. Quel est en effet la situation de ce dernier à l’égard du bien public ? Une remarque de Mandeville ne laisse aucun doute à ce sujet :
« Quand je parle si honorablement de ce vice [ la prodigalité ], c’est par le même souci qui m’a rendu si injurieux de son contraire [ la cupidité ], c’est-à-dire le souci du bien public » (p87)
Le penseur s’exempte donc de l’insouciance du bien public qu’il recommande si vivement à tous ses concitoyens : les abeilles, pour le propre bonheur, doivent oublier le bien public, mais le moraliste, pour le bonheur des abeilles, doit s’en soucier.
La fable économique
La fable de Mandeville n’est pas seulement une parabole. A la manière de celles de la Fontaine, elle se termine par une morale. Longue d’une page, celle ci commence par ces lignes
« Cessez donc de vous plaindre [des vices des hommes]
Seuls les fous veulent rendre honnête une grande ruche »
et continue comme suit :
« Ainsi on constate que le vice est bénéfique
Quand il est émondé et restreint par la justice » (p92)
On constate que cette morale (de même que le titre de la fable) est tout simplement l’inverse du dicton bien connu « l’enfer est pavé de bonnes intentions », dicton qu’illustre exactement la seconde partie de la fable, qui voit la cité devenue vertueuse ( « et l’honnêteté emplit leurs cœurs » ) tomber en ruines.
Cette morale est commune à tous les récits économiques. Elle présuppose l’idée du bien public à atteindre. Si l’économiste, à l’imitation de nombreux écrivains, se contentait d’un regard neutre sur ses personnages et les situations qu’il décrit, le récit économique s’apparenterait plus à une chronique : les individus, sans le vouloir, atteignent un but sur lequel le narrateur ne porte pas de jugement. Mais l’économiste mesure le résultat atteint involontairement par ses personnages, à l’aune d’un idéal collectif. C’est ce qui fait de son récit une fable, non au sens d’un récit auquel on ne peut prêter foi, mais au sens d’une parabole porteuse d’une morale.
Les récits ultérieurs
Voyons maintenant comment les parties du récit que l’on a identifiées chez Mandeville, ont subsisté dans la littérature économique.
On a distingué 5 éléments
- les vices privés
- le bien public
- les comportements des individus
- le mécanisme qui transforme les comportements en bien public
- l’action de l’Etat qui doit rendre possible l’ensemble du processus.
Donnons leur des noms génériques.
L’élément : attitude individuelle. Cette attitude résume les ‘vices privés’ de Mandeville. Les individus ont une attitude oublieuse du bien public auquel ils ne s’intéressent pas. Cet élément est le plus immédiat, et nous en avons déjà parlé en introduction.
L’élément : bien public (= intérêt général). C’est la ‘vertu publique’ de Mandeville. Il s’agit de la définition de l’intérêt général et des critères qui permettent de le définir.
L’élément (ou épisode) comportement que nous appelons ainsi par référence au titre du célèbre ouvrage de von Neumann et Morgernstern « Theory of games and economic behaviour » (1944). Il s’agit de la ‘démonstration des vices’ de Mandeville. Cet élément part de la subjectivité des individus ( chez Mandeville, la prodigalité et les autres vices ), pour parvenir à leurs actions (chez Mandeville, les dépenses en biens de luxe).
L’élément (ou épisode) mécanisme. Il explique comment les actes inspirés par les vices, permettent que le bien public soit atteint. La psychologie ne joue ici plus aucun rôle : que les riches dépensent par prodigalité, par souci du bien public ou pour toute autre raison n’a ici plus d’importance. Cet élément part des actions pour arriver à leur résultat collectif (ici, le plein emploi), dont l’auteur reconnaît le caractère heureux.
L’élément (ou épisode) action consciente de l’Etat (réduit à sa plus simple expression chez Mandeville). Il décrit comment l’Etat influe sur les comportements ou contribue à actionner le mécanisme, afin que le résultat collectif soit conforme au bien public.
L’élément ‘comportement’ et l’élément ‘mécanisme’ constituent en général la plus grande part des récits économiques.
La « Fable des abeilles » est un récit ‘complet’, c’est à dire qu’il contient les 5 éléments que l’on a distingués. Mais ce n’est pas le cas de tous les récits économiques. Beaucoup d’entre eux sont des récits ‘incomplets’, à l’image de la célèbre rencontre des deux sauvages dans l’article inachevé de Turgot « Valeurs et monnaies »(1769), qui ne contient que l’élément ou épisode ‘comportement’.
On peut représenter les éléments du récit économique par le schéma suivant :
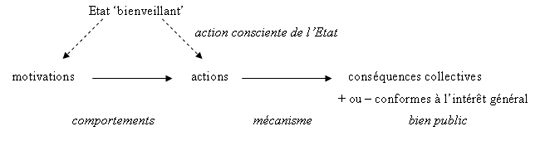
S2 : Un récit exemplaire : l’œuvre de Walras
Léon Walras (1834 - 1910), est un économiste exemplaire pour trois raisons.
D’abord, il est le ‘père’ de la théorie de l’équilibre général, la théorie économique la plus ambitieuse jamais conçue.
Ensuite (et à cause de cela) Walras est le plus connu des économistes néoclassiques, et un modèle pour ses successeurs jusqu’à aujourd’hui.
Et enfin, Walras inscrit sa théorie des prix dans une conception politique et morale de la cité, une attitude philosophique qui – après une période d’éclipse – est de nouveau revendiquée par les économistes modernes.
Comme certains écrivains qui décrivent minutieusement tous les aspects d’un monde de fantaisie, Walras décrit minutieusement tous les aspects de « l’idéal social » (dont il pense par ailleurs que l’histoire est en train de le réaliser). Il embrasse donc, dans l’ensemble de son œuvre, tous les épisodes du récit économique et toutes les étapes de la doctrine économiste. Il révèle ainsi la grande cohérence qui existe entre ces épisodes et entre ces étapes, cohérence que la division du travail ultérieure entre les économistes de profession a, par la suite, rendue moins apparente.
Pour résumer brutalement l’œuvre de Walras, on pourrait dire que Walras écrit un récit ‘à la Mandeville’, ayant pour cadre la prison panoptique de Bentham.
En effet, Walras partage avec Mandeville l’idée que la poursuite par chacun de ses appétits de consommation peut conduire au meilleur état social. Mais Walras partage avec Bentham, l’idée d’un Etat indépendant, déduit de la seule raison, et supervisant toute la société. Walras instrumentalise donc le récit ‘à la Mandeville’ en le tirant de l’état de nature, et en le plaçant dans la cité idéale dont il se fait le législateur .
En d’autres termes, les énoncés de Walras et de ses successeurs ont une portée politique. C’est ce qui fait que nous les considérons comme « normatifs ». Walras a d’ailleurs écrit dans une de ses « notes d’humeur » : « …je crois que le but final de la science est de rapprocher la réalité d’un certain idéal »(cité par JP Potier).
« économie pure » ; « économie appliquée » ; « économie sociale ».
Le livre le plus connu de Walras, les « Eléments d’économie politique pure », fait partie d’une trilogie, qui comprend également les « Etudes d’économie sociale » et les « études d’économie appliquée ». Ces « études » sont des recueils d’articles, regroupés par thèmes en chapitres. Si l’ « économie pure » est un traité alors que l’ « économie sociale » et l’ « économie appliquée » sont restées à l’état d’études, c’est que Walras, qui jugeait la première, prioritaire, n’a pas eu le temps d’unifier les deux dernières : il n’a pas repris et retravaillé, les cours qu’il donnait, dans ces matières, à l’université de Lausanne.
Néanmoins, plusieurs auteurs ont montré récemment que « l’économie pure » ne prenait son sens – et en particulier sa valeur normative – que reliée à l’économie sociale et à l’économie appliquée. Ils ont mis en lumière la complémentarité entre ces trois volumes, longtemps masquée par l’attention portée à la question de l’unicité et de la stabilité de l’équilibre général.
Les trois volumes de la ‘trilogie’ de Walras, correspondent à peu de choses près, à quatre des cinq éléments narratifs que l’on a repérés dans la fable de Mandeville.
« L’économie pure » c’est avant tout l’explication des mécanismes économiques que sont le fameux « tâtonnement », la procédure itérative qui conduit à l’équilibre général, et les « livraisons réciproques » qui lui font suite ; un ensemble que A.Berthoud a appelé « La machine d’échange ». D’ailleurs, Walras lui-même compare sa science à la mécanique ou à l’astronomie.
L’économie pure, c’est aussi, à la fin de chaque section, la liaison de ce mécanisme avec les comportements économiques, avec un renvoi à l’économie appliquée.
« L’économie appliquée » c’est la recherche de ce que doit être l’action consciente de l’Etat. Mais pour Walras, ce que l’Etat doit faire, c’est le résidu ; c’est ce que ne peuvent pas faire les agents économiques à la poursuite de leurs intérêts particuliers. L’économie appliquée est donc également l’étude des comportements économiques. Il s’agit en effet de rechercher comment « la satisfaction de l’intérêt personnel concorde… avec la satisfaction de l’intérêt général »(EA p382) avant de faire intervenir l’Etat, là où cette concordance n’est pas assurée.
« L’économie sociale » enfin, c’est la détermination scientifique de la « justice » économique et sociale, la forme walrasienne du bien public. Cet élément, très sommaire chez Mandeville qui ne pose pas de norme précise, est très approfondi chez Walras, qui bâtit une cité idéale.
Aucun ouvrage de Walras ne traite de l’attitude individuelle de non-souveraineté, mais elle est implicite dès le départ. Dans une célèbre lettre à Walras, le mathématicien Henri Poincaré écrit même que les agents économiques de Walras sont ‘infiniment égoïstes’.
L’articulation des mécanismes et des comportements dans l’échange
La théorie de l’échange de Walras nous paraît présentée d’une manière qui illustre bien l’articulation entre un mécanisme économique et un comportement économique.
le mécanisme de l’échange
Dans ses « éléments d’économie politique pure », Walras commence par étudier l’échange sans production. Il commence par supposer qu’il n’y a que deux marchandises à échanger, les marchandises A et B. C’est la section II « l’échange de deux marchandises entre elles ».
Il y a deux sortes d’individus. Les « porteurs de A », qui détiennent du A, et les « porteurs de B », qui détiennent du B.
Au début, Walras affirme qu’il pose les fonctions d’offre et de demande « empiriquement », ce qui fait que, dans la pratique, elles sont données. Le passage suivant nous paraît très significatif :
« Si notre homme[…] était empêché de se rendre en personne sur le marché, ou si, pour une raison ou pour une autre, il devait donner sa commission à un ami ou ses ordres à un agent, il devrait prévoir toutes les valeurs possibles de pa depuis zéro jusqu'à l’infini, et déterminer en conséquence toutes les valeurs correspondantes de da en les exprimant d’une manière quelconque »EPp83
Les amis ou les agents sont les messagers des actions (les demandes), tout en étant dans l’ignorance des motivations de leurs commanditaires (les préférences). Ceci indique que c’est de l’étude d’un mécanisme dont il va être question. L’économiste ‘ramasse’ en quelque sorte, ces demandes individuelles, puis les agrège pour déduire l’offre et la demande sur le marché
« Lorsque la demande effective de (A) en (B) sera Da,m au prix pa,m , l’offre effective de (B) contre (A) sera par cela même Ob,m = Da,mpa,m »(p87).
Ayant additionné ses courbes d’offre et de demande, l’économiste détermine alors graphiquement et mathématiquement, le point où elles sont égales : l’équilibre.
les motivations des échangistes
Ce n’est qu’après avoir fait cela, à la fin de la section, que Walras se demande quelle est « la circonstance déterminante des courbes de demande partielle ». Autrement dit, qu’il se demande quelle est la motivation qui a conduit les consommateurs à adresser des courbes de demande déterminées à leurs ‘amis’.
« Revenons aux courbes de demande partielle... La longueur Oad,1 représente la quantité effectivement demandée de (A) par ce porteur au prix de 0 , c’est à dire la quantité qui serait consommée par lui si cette marchandise était gratuite. Or de quoi dépend généralement cette quantité ? D’un certain genre d’utilité... »(EPp104).
Donc si les consommateurs offrent et demandent des marchandises A et B en telle et telle quantité, c’est en fonction de l’utilité relative qu’ils ressentent pour les deux marchandises. Walras montre alors que l’équilibre permet d’atteindre « le maximum d’utilité » pour tous les échangistes .
Walras raisonne donc en étudiant d’abord le mécanisme du marché, puis les motivations des échangistes.
Dans la « théorie de la production », ceci est beaucoup moins net, mais il nous semble que l’on pourrait toujours logiquement séparer, dans son raisonnement, le mécanisme et les comportements.
Le découpage du récit de Walras et le projet de l’économiste
Les distinctions que fait Walras entre l’économie pure, l’économie appliquée et l’économie sociale, et la manière dont il articule les mécanismes et les comportements, nous semblent en rapport avec sa volonté de, clarifier son projet par rapport aux doctrines socialiste et libérale dont il fait la synthèse.
Walras partage avec les socialistes la volonté de déterminer scientifiquement une « formule sociale définitive », c’est à dire une définition rationnelle et universelle du bien public.
Mais Walras ne veut pas rester dans l’utopie. Il veut démonter scientifiquement qu’il est possible d’atteindre l’idéal social ; c’est ce qu’il fait dans son économie pure.
Ensuite, Walras partage avec les libéraux, le respect de l’initiative privée. Il souhaite donc que le bien public soit réalisé spontanément, dans la liberté d’entreprendre, et non dans le despotisme et l’économie de commandement. C’est ce souhait dont il démontre la possibilité dans les dernières pages de chacun de ces chapitres de l’économie pure, et dans son économie appliquée. Dans l’ « Economie appliquée », Walras traite en général de front les comportements des agents et l’action de l’Etat, puisqu’un mécanisme ne peut être mis en œuvre que par des agents soucieux de leur intérêt, ou par un Etat dévoué, par hypothèse chez Walras, au bien public.
S3 : Les ‘récits’ économiques après Walras
De notre point de vue, la postérité de Walras ne réside pas seulement dans la théorie moderne de l’équilibre général, ou dans les modèles économétriques d’équilibre général calculable. Elle réside en même temps dans la méthode littéraire et le projet politique dont nous avons déjà parlé.
On peut vérifier que les éléments du ‘récit’ économique que l’on avait distingués chez Mandeville et dont on vient de voir l’articulation dans les raisonnements de Walras, se retrouvent, tels qu’en eux mêmes, dans l’économie d’aujourd’hui.
Un exemple : l’équilibre partiel
Prenons la situation la plus banale : la découverte du prix d’équilibre (partiel) sur le marché.
Il est tout à fait logique, et c’est d’ailleurs ce que font la plupart des manuels, de traiter d’abord, ‘le consommateur’ et ‘le producteur’, c’est-à-dire la construction des fonctions d’offre et de demande ; et ensuite, l’équilibre sur le marché. En effet, la construction des fonctions correspond à l’élément ‘comportement’ du récit, et la recherche de leurs coordonnées communes correspond à l’élément ‘mécanisme’ du même récit.
. L’élément comportement : des intentions aux actions.
Le consommateur classe ses paniers potentiels, il cherche à maximiser son utilité. Le producteur cherche à maximiser son profit.
La question est : que vont-ils faire pour maximiser cette utilité, ce profit ?
La réponse est : pour tel prix, ils vont demander (pour les uns) et offrir (pour les autres) telle quantité de bien. Pour tel autre prix, ils vont demander ou offrir, telle autre quantité.
La préoccupation est donc comportementale : on se demande ce que les individus vont faire ; ce qu’ils vont choisir.
. L’élément mécanisme : des actions au résultat.
Maintenant que les fonctions d’offre et de demande sont connues, il s’agit de déterminer, par la recherche des coordonnées communes, le prix et la quantité d’équilibre. On part des choix précédemment déterminés ou tout simplement postulés (on ‘se donne’ une fonction d’offre et une fonction de demande) et on en déduit la conséquence collective, qui est le prix d’équilibre partiel.
Un exemple : l’entrée dans la branche
Voyons de la même manière l’entrée dans la branche.
On peut repérer quatre des cinq éléments dans ce ‘récit’ économique.
. L’élément attitude individuelle
:Les producteurs ne recherchent que leur propre profit, et non pas le bien public, ni même ce bien public ‘corporatiste’, que constituerait la maximisation de la somme des profits des entreprises entrantes. De même, les consommateurs ne recherchent que la satisfaction qu’ils retirent de leur consommation.
. L’élément bien public :
Le bien public est représenté, dans la tradition marshallienne, par le surplus total.
. L’élément comportement :
Chaque entreprise, en fonction de la différence positive ou nulle (ou éventuellement négative) entre le prix de marché et son coût, choisit d’entrer ou non.
. L’élément mécanisme :
Certains producteurs entrent, et en conséquence, le prix de marché baisse jusqu’au point où il rejoint le coût moyen, une conséquence collective qui n’est pas désirée par les producteurs (bien au contraire)
La différence entre comportement et mécanisme, ressort bien, à notre avis, dans la remarque suivante de K.Arrow
« Il faut d’abord écarter une opinion, à savoir qu’une théorie de l’économie, ne peut, en principe, qu’être fondée sur la notion de rationalité [... ]. Dans le cas de la demande du consommateur, la contrainte budgétaire doit bien sûr être satisfaite, mais on peut aisément imaginer nombre de théories fort différentes de la maximisation de l’utilité. Par exemple, la formation des habitudes peut servir de base à une théorie... Il s’agira de choisir le panier de consommation qui satisfasse la contrainte budgétaire et occasionne le moindre changement relativement au panier initial... Cette théorie n’est pas rationnelle au sens ou les économistes l’entendent [... ] [pourtant] cette théorie n’est pas seulement une explication logiquement complète du comportement, elle est aussi plus puissante que la théorie standard, et se prête au moins aussi bien aux tests empiriques » (Arrow 1979 p23-24)
De notre point de vue, ce que dit Arrow, c’est que dans la théorie de l’équilibre général, le comportement des ménages peut prendre (au moins) deux formes différentes :
- la maximisation d’une fonction d’utilité (sous contrainte de budget)
- la minimisation de l’évolution du panier consommé (sous contrainte de budget)
Ces deux formes comportementales peuvent être ‘branchées’, sur un même mécanisme : l’équilibre entre l’offre et la demande.
Récit à l’endroit et récit à l’envers
Il y a deux manières différentes de placer, dans un récit économique, les comportements et les mécanismes. On peut décrire d’abord les comportements : on parlera de récits ‘à l’endroit’ ; ou bien on peut décrire d’abord les mécanismes : on parlera de récit ‘à l’envers’.
Un récit à l’endroit : le salaire d’efficience.
Presque tous les récits économiques sont ‘à l’endroit’. La narration suit l’ordre chronologique des évènements. L’auteur commence par exposer les motivations des agents. Par l’étude de leurs comportements, il parvient à déterminer leurs actions, puis il décrit ensuite le mécanisme qui, partant de ces actions, aboutit au résultat collectif. Il peut alors juger ce résultat.
Dans l’ « histoire » du salaire d’efficience, par exemple, le point de départ est l’ « opportunisme » des travailleurs, autrement dit, leur envie de ‘tirer au flan’.
les comportements
Formellement, la fixation du salaire d’efficience est l’issue d’un jeu séquentiel avec action cachée. Supposons qu’au départ, le salaire soit le salaire d’équilibre.
Les travailleurs sont désireux de maximiser leur utilité qui dépend de leur revenu et de leur effort. Ce qui peut les inciter à l’effort, c’est que 1) s’ils tirent au flan, ils peuvent être repérés, et 2) le fait d’être repéré diminue leurs perspectives de revenu.
Les entreprises, elles, sont désireuses de maximiser leur profit, qui dépend de l’effort des travailleurs. Elles vont donc payer des surveillants pour repérer ceux qui tenteraient de tirer au flan. Mais cela ne sert à rien si le travailleur repéré, aussitôt mis à la porte, retrouve immédiatement du travail au même salaire, chez un concurrent. Pour rendre la paresse ‘coûteuse’, l’entreprise doit verser un salaire supérieur au salaire de marché. Toutes les entreprises décident donc de verser ce salaire ‘d’efficience’ plus élevé.
le mécanisme
Le mécanisme, très simple dans cette histoire, c’est ce qui explique le lien entre ces décisions, et sa conséquence non voulue : l’apparition du chômage involontaire. Il est clair en effet que, si toutes les entreprises versent des salaires supérieurs au salaire d’équilibre, si on suppose que l’offre de travail croit avec le salaire (ce qui relève des comportements), alors l’offre va se retrouver supérieure à la demande, et ceux qui se font prendre à tirer au flan, au lieu de se retrouver avec un salaire moins élevé, se retrouveront – pour certains d’entre eux – au chômage.
le bien public
Que penser de ce résultat ? Il est le meilleur possible, compte tenu du fait que les travailleurs sont opportunistes (si les entrepreneurs payaient le salaire d’équilibre, la production serait nulle). Cependant, une partie des malchanceux qui se sont fait repérer à tirer au flan se retrouvent au chômage avec un revenu monétaire nul.
Décrire ainsi les mécanismes ‘dans la foulée’ des comportements, est la forme la plus naturelle du récit économique. De plus, l’écrivain/économiste est alors assuré que le résultat est en conformité avec les motivations des individus.
Des récits à l’envers : la théorie moderne de l’équilibre général
On peut cependant aborder un problème économique d’une manière inversée, en partant du bien public à atteindre, et en se posant la question « A quelles conditions… ». C’est ce qu’ont fait, à la suite de Walras, les théoriciens modernes de l’équilibre général. Le récit inverse alors la chronologie de l’histoire.
Le bien public
Le bien public que l’on veut atteindre, c’est l’équilibre général
Le mécanisme
A quelles conditions est il accessible. Autrement dit, quelles sont les conditions d’existence et de stabilité de l’équilibre ? Il faut que les fonctions d’offre et de demande soient définies et continues, pour tout ‘vecteur de prix’. Le mécanisme est ce qui permet de tirer de ces offres et ces demandes adéquates, le prix d’équilibre.
Les comportements
A quelles conditions maintenant, les fonctions d’offre et de demandes sont-elles partout définies et continues ? Il faut que les préférences sont elles mêmes continues, et qu’elles soient convexes. Les comportements font le lien entre ces conditions ‘psychologiques’ et les conditions ‘techniques’ sur les offres et les demandes .
Le récit « à l’envers » est plus normatif dans sa construction, puisque les mécanismes à mettre en œuvres, et jusqu’aux préférences des agents sont déterminées par le résultat à atteindre. Cette manière de raisonner et d’écrire, dans le domaine de l’équilibre général nous semble héritée de Walras, qui lui même raisonne ‘à l’envers’ ; comme on l’a vu.
Il est plus cohérent, du point de vue mormatif, de se préoccuper d’abord de définir le bien public et d’établir par quels mécanismes on le met en place, puis de faire actionner ces mécanismes par des individus soucieux de leur propre intérêt : dans un premier temps on définit l’objectif à atteindre (le bien public), puis dans un second temps on définit l’outil qui permet d’y parvenir (le mécanisme) et enfin, dans un troisième temps, on examine comment inciter les agents à se servir de cet outil (le comportements).
L’écriture, ‘à l’envers’, si elle est moins naturelle, nous paraît donc d’une plus grande lucidité idéologique.
Conclusion
Les économistes qui succèderont à Walras, à commencer par Pareto, et jusqu’à aujourd’hui, apporterons des réponses parfois différentes, mais nous pensons que les questions qu’ils se posent sont les mêmes, et que chacun apporte sa pierre à la construction intellectuelle de la cité idéale. On va donc essayer de montrer l’unité doctrinale de la science économique depuis Walras, en comparant les solutions de Walras et celles de ses successeurs. C’est à dire que, partant de Walras, nous aborderons les travaux des économistes plus récents qui nous semblent avoir avancé dans le grand projet collectif qui constitue à nos yeux la théorie économique.
Nous allons maintenant étudier en détail chacun des ‘éléments’ du récit économique, pour voir comment le respect de la contrainte littéraire donne naissance au projet politique.