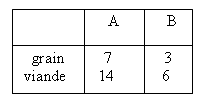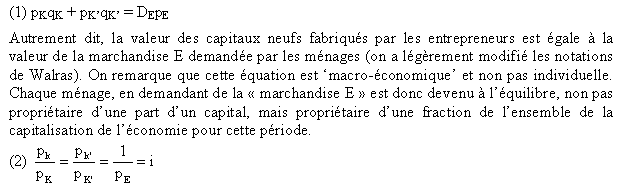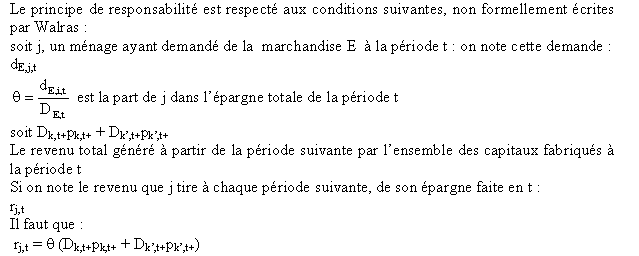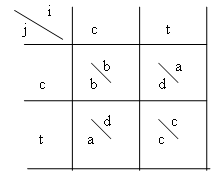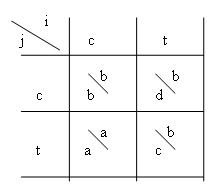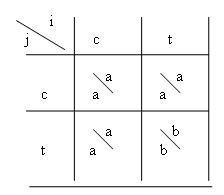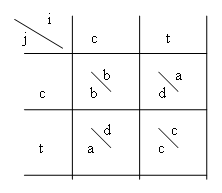Introduction
Ainsi que nous l’avons rappelé dans l’introduction générale, le bien public des économistes est toujours un état social (par exemple une allocation optimale) ou une procédure que l’on peut répliquer (le troc jevonien de Walras). Selon le principe choisi par l’économiste, il existe pour chaque situation, une ou des distributions justes ou efficaces et donc conformes à l’intérêt général.
La définition du bien public est largement indépendante des moyens techniques et intellectuels utilisés pour le déterminer. Par exemple, le bien public utilitariste (la maximisation de l’utilité totale) a été retrouvé par Harsanyi par le moyen d’un raisonnement sous ‘voile d’ignorance’.
L’économie normative et l’éthique sociale sont un champ en constante expansion et on se limitera à la tradition.
Ce qui nous intéresse, ce sont ces moyens utilisés pour déterminer le bien public.
Notre but, dans ce chapitre, est double.
Nous souhaitons d’abord rappeler de quelle manière les économistes ‘fabriquent’ ou justifient leurs définitions de l’intérêt général. Il s’agit donc de présenter à notre manière la méthodologie de l’économie normative.
Nous souhaitons également et surtout, faire ressortir le fait que les individus imaginés par les économistes ne veulent pas plus le bien public au moment ou il est défini qu’au moment ou il sera atteint. Plus même, les formes du bien public proposées par les économistes nous semblent favoriser une morale qui prescrit de se soucier de son propre intérêt.
Ce chapitre comprend trois sections.
Dans la première section, nous examinons s’il existe une originalité des économistes – nommément de Walras et de Pareto – dans la méthode de détermination du bien public. On s’intéresse en particulier au rôle des individus ‘autocentrés’ dans cette détermination.
Dans la seconde section, on discute et on tente d’adapter aux versions économistes du bien public, un argument présenté par le philosophe Gerald Cohen à propos du ‘principe de différence’ de Rawls. On se demande si des individus engagés dans la situation peuvent vouloir consciemment le bien public tel qu’il a été défini par l’économiste.
Dans la troisième section consacrée à la morale de responsabilité, on verra que cette morale a un lien très étroit avec l’idée d’agents insoucieux du bien public et on verra également que le bien public défini par Walras a justement en partie pour objet d’assurer le respect de cette morale.
S1 : La détermination du bien public
On parlera :
- de la définition du bien public quand il s’agit d’exposer le contenu du bien public (par exemple l’utilité totale).
- de la détermination du bien public quand il s’agit d’exposer la méthode par laquelle on parvient à décider que le bien public doit recevoir tel contenu (par exemple : le ‘voile d’ignorance’).
Bien que le sujet de l’économie normative soit seulement le bien être ‘social’ ou la justice ‘sociale’, les méthodes de détermination du bien public par les économistes ne peuvent être différentes des méthodes acceptées en philosophie morale et politique, au point que l’économie normative apparaît de plus en plus comme une partie de cette philosophie. L’économie normative a connu un important regain d’intérêt depuis le résultat négatif de Arrow (1951) sur l’impossibilité de construire une fonction de préférence collective à partir des préférences individuelles dans un cadre démocratique, et depuis la critique vigoureuse de l’utilitarisme par le philosophe John Rawls dans son célèbre ouvrage « Théorie de la justice » (1971) En effet, l’addition des utilités individuelle – supposées cardinales et additionnables – était une définition du bien public très utilisée en économie comme base de toutes les fonctions d’utilité collective .
Il nous semble que la critique de John Rawls a provoqué une réinterprétation contractualiste de la plupart des normes économiques par les économistes eux-mêmes, le contractualisme étant présentée désormais comme la seule méthode légitime de détermination du bien public. Ainsi, A.Rosenberg (1992) écrit :
« Imaginons un grand nombre d’agents rationnels qui se sont déjà mis d’accord sur les avantages que chacun retirerait de l’existence d’un Etat ayant l’autorité reconnue pour les obliger à appliquer les règles auxquelles ils auraient donné leur accord… Ces individus en arrivent au sujet des institutions qu’ils vont établir »(pp118-9) « Sur quelles institutions s’accorderont-ils lorsqu’ils contracteront pour les établir ? »(p220). « Le commissaire-priseur est celui qui rend les offres et les demandes égales. Sa position est peu différente de celle du souverain de Hobbes »(p123)
Bien que ce mouvement soit peut être destiné à entraîner une contractualisation complète de l’économie normative diverses autres méthodes de détermination du bien public ont été utilisées par les économistes et en particulier par Walras. Ce qui nous intéresse c’est que toutes ces méthodes contiennent un invariant : elles utilisent des individus qui ne s’intéressent pas au bien public.
La découverte du bien public est en fait un récit économique en miniature, puisque ce sont des agents, à la recherche de leur propre intérêt, qui vont – avec l’assistance bienveillante de l’économiste – déterminer le bien public. De nouveau, ce que Wladimir Propp dit de la structure des contes de fées, s’applique ici.
« Un élément du conte quel qu’il soit, peut être, pour ainsi dire, envahi par l’action, peut se transformer en récit indépendant, peut faire naître un récit. Mais comme tout ce qui vit, le conte n’engendre que des enfants qui lui ressemblent. Si une cellule de cet organisme se transforme en petit conte dans le conte, celui ci se construit, ainsi que nous le verrons plus loin, selon les mêmes lois que n’importe quel autre conte merveilleux » (Propp 1928 p95)
La méthode de l’observation
Ce qualificatif est de notre invention. On appelle ainsi la méthode utilisée par Marshall et par Pigou notamment, pour justifier l’utilisation d’une définition utilitariste du bien public. Cette méthode s’opposerait à la méthode ‘procédurale’ revendiquée par Rawls comme seule légitime. Une opposition terme à terme conduirait à la qualifier de ‘substantive’, mais le caractère ‘substantiel’ du bien public, ne dit rien de la méthode qui a permis de la déterminer, si ce n’est qu’elle n’est pas ‘purement procédurale’. De plus, il nous semble difficile d’appliquer des notions philosophiques à la méthode employée par Marshall, puisque celui ci la justifie par des considérations pratiques, et – à notre connaissance – pas du tout philosophiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle reste utilisée aujourd’hui, comme substitut commode à l’optimum de Pareto.
Avec la ‘méthode de l’observation’, le bien public est déterminé par l’économiste après observation des agents.
Il y a donc deux temps :
- un temps d’observation et d’objectivation des préférences individuelles.
- un temps d’intervention de l’économiste pour refondre ces données individuelles en une norme collective.
Le ‘surplus des consommateurs’ de Marshall.
Cette norme, ainsi que Marshall le fait remarquer en note, est dérivée de l’ ‘utilité totale’ de Dupuit.
Le premier temps est l’observation, d’une absolue neutralité, du comportement d’un consommateur (Marshall semble penser que pour connaître la fonction de demande d’un consommateur, il suffit de l’observer).
« Prenons l’exemple d’un homme, qui, si le prix du thé était de 20sh la livre, n’en achèterait qu’une livre par an, qui en achèterait deux livres si le prix était de 14sh, trois livres si le prix était de 10sh, quatre livres avec un prix de 6sh, et qui en achète sept livres au prix de 2sh qu’atteint le blé en ce moment. Nous avons à rechercher quel est le bénéfice qu’il retire de cette possibilité d’acheter du thé à 2sh la livre »(vol1 p265.)
Après calcul, on trouve que
« son bénéfice de consommateur est au moins égal à la différence entre cette somme [la somme qu’il débourserait pour les 7 livres, s’il achetait la première livre 20sh, la deuxième livre 14sh...] et les 14sh qu’il paye réellement pour elles, c’est à dire 45sh. En d’autres termes, il doit ces 45sh supplémentaires à sa conjoncture, à l’adaptation du milieu à ses besoins »p208.
Il est donc tout à fait clair que, en achetant son thé sur un marché en concurrence, et non à un monopole discriminant, cet homme a économisé 45sh. Dans les exemples simples qu’il donne de l’application de son principe, Marshall passe du surplus du consommateur au surplus des consommateurs, en additionnant simplement les shillings ainsi économisés. Mais cette simplification est d’un usage simplement didactique. L’économiste est tout à fait conscient que cette addition de total numéraire ne peut constituer directement la mesure de la norme de bien public.
Le second temps est l’intervention de l’économiste. Il faudrait
« envisager ce fait qu’un plaisir de la valeur d’une livre sterling est, pour un homme pauvre quelque chose de beaucoup plus grand qu’un plaisir de la valeur d’une livre pour un homme riche »p272, et que « des personnes d’une sensibilité générale très grande souffrent de la perte d’une certaine partie de leur revenus, plus que d’autres personnes placées dans une situation de fortune semblable »(note p272).
L’économiste doit donc intervenir pour affecter une valeur à chacun des shillings économisés, pour passer du gain monétaire à la mesure du bien public.
la fonction d’utilité collective de Samuelson (1947)
Il s’agit de maximiser une telle fonction « sans faire d’hypothèses sur la possibilité de comparer l’utilité entre les individus ».(Samuelson 1995 [1947] p77) Samuelson qui cherche l’expression la plus large possible de cette fonction propose :
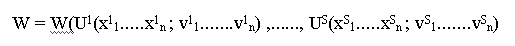
où 1,...,S, représentent les individus, x, les quantités de biens consommés, et v les quantités de services offerts. Faisant le parallèle avec le monopole bilatéral, Samuelson souligne que
« sans fonction W bien déterminée, c’est à dire sans hypothèses concernant les comparaisons d’utilités entre les individus, on ne peut décider lequel des points de la courbe (des contrats) est le meilleur. Ce n’est que par rapport à un ensemble donné de notions morales qui définissent une fonction de bien être que le meilleur point du lieu de contrat généralisé peut être déterminé »(p75). Samuelson propose de « réduire le niveau d’indétermination du système jusqu'à une égalité implicite entre le niveau de bien être des différents individus du système. Ceci peut s’écrire :
P ( U1,U2,...,US) = 0
C’est à dire que nous pouvons spécifier à volonté les niveaux de bien être de tous les individus et que le bien-être du dernier individu est déterminé de manière unique »
L’économiste est maintenant conscient que ses pondérations sont arbitraires, mais il ne s’empêche pas pour autant d’en choisir certaines pour définir le bien public.
Le contractualisme
Le contractualisme est en quelque sorte la méthode polaire par rapport à ce que l’on a appelé la ‘méthode de l’observation’. Avec la ‘méthode de l’observation’, les individus (insoucieux du bien public) n’ont pas à s’exprimer. C’est l’observateur qui détermine seul le bien public. Dans le contractualisme, par définition, ce sont les individus eux-mêmes qui énoncent quel sera le bien public.
Le contractualisme n’est pas propre aux économistes et a été emprunté par eux aux philosophes. Mais ce qui nous intéresse, c’est que l’attitude insoucieuse du bien public des co-contractants n’est pas non plus propre aux économistes. Elle n’est donc pas un reflet de la psychologie du consommateur, ni un témoignage de l’incapacité des individus à traiter l’information. Elle fait partie de la méthode elle-même.
Rawls, en parlant des contractants, parle d’une attitude de ‘désintérêt mutuel’. Ainsi que l’a très bien vu Ph. van Parijs, cette attitude est tout simplement de l’indifférence mutuelle. Autrement dit les agents sont ‘autocentrés’. Cette attitude est justifiée par Rawls par le fait que, sous le ‘voile d’ignorance’, elle met chaque individu dans la position d’un spectateur impartial. Cette argumentation laisse à penser que cette attitude indifférente des agents ne se justifie que parce que les individus sont sous voile d’ignorance. Cependant, chez les économistes (et peut être aussi chez certains philosophes) cette indifférence a une valeur en elle-même ; autrement dit, elle fait partie de la méthode de détermination du bien public hors de tout ‘voile d’ignorance’. C’est ce que nous nous proposons de montrer en présentant le contractualisme de John Buchanan.
Le contrat constitutionnel de Buchanan
James Buchanan est, de notre point de vue, un auteur qui est passé du libéralisme à l’économisme. Le livre qui l’a fait connaître, écrit avec Gordon Tullock : « The calculus of consent »(1962) ‘explique’ pourquoi des individus ‘rationnels’ pourraient choisir de prendre des décisions à la majorité plutôt qu’à l’unanimité, sans que personne n’en ait eu l’intention au départ.
Nous commenterons un autre ouvrage « Les limites de la liberté » (1975), qui nous paraît constituer un ‘tournant économiste’ dans la pensée de cet auteur. Buchanan commence par y dénoncer ce qu’il appelle « l’utopie anarchiste » c’est à dire le libertarisme. Un monde « Ou les individus restent libres de ‘faire ce qui leur plait’ et les actions menées en commun sont strictement volontaires »(p3). Il va ensuite opposer à cette « utopie non communiste », sa « théorie du contrat constitutionnel ».
Buchanan remarque que « notre façon d’aborder les choses est très proche de celle de John Rawls, qui a tenté de dériver des principes généraux de justice d’une manière analogue »(p83). Ce que Buchanan cherche à fonder, ce sont des droits de propriété, ou plus exactement, des droits de propriété qui permettent une amélioration paretienne par rapport à un état initial d’anarchie.
La détermination du bien public
Cette détermination fait l’objet du chapitre 4 : « Contrat constitutionnel : la théorie du droit »
Le récit de Buchanan est une robinsonnade revendiquée :
« Soit deux individus, chacun sur son île, complètement isolés l’un de l’autre et sans contact social. Chacun peut atteindre, dans son comportement, un équilibre déterminé par [ses préférences] et par sa capacité intrinsèque de transformer des éléments de base en produits »(p66)
« Imaginons [maintenant] que nos deux personnes – nommons les A et B – ne soient plus complètement isolées, mais occupent plutôt des espaces distincts sur une même île. Ce changement […] affectera l’environnement de chacune d’elles chacune considérant désormais l’autre, dans ce monde sans lois, comme un élément de son environnement »(p67)
« Si la production n’est pas effectuée au moment même de la consommation, les individus peuvent stocker des produits pour l’avenir. Dans un tel cas, la présence de B peut conduire A à consacrer des efforts […] à la dissimulation de ses provisions, et à la défense de celles ci contre le vol. Comme ses efforts de protection auraient pu, sans cela, servir à produire directement des biens, A voit alors son taux de transformation diminuer.» D’autre part, « S’il sait que B produit et stocke des choses, il peut considérer qu’il est plus productif pour lui de rechercher les provisions de B et de s’en emparer, que de fabriquer les mêmes provisions de ses propres mains »(p67)
Buchanan compare deux points, les points X et Y d’équilibre en autarcie (deux îles), et le point E, d’équilibre à l’Etat d’anarchie (une seule île)
« A fin d’illustration, disons qu’à l’origine (X,Y) A consacre six unités d’efforts pour obtenir, tout compte fait, dix unités de banane, tandis que B obtient douze unités de bien pour cinq unités d’effort »p68.
« L’équilibre, dans ce monde purement anarchiste est atteint en E, point ou aucune des deux personnes n’a intérêt à prendre l’initiative de nouvelles actions. Dans cette situation d’équilibre, chacun répartira vraisemblablement ses efforts entre la protection de ses provisions, le pillage des provisions de l’autre, et la production directe pour lui-même . »p69
Buchanan montre ensuite qu’un accord fondant les droits de propriété n’est possible que si les deux individus sont mécontents quand l’anarchie (1 seul île) remplace l’autarcie (2 îles). Ce n’est pas forcément le cas. Il se pourrait en effet que :
« Au moins une des deux personnes [soit] susceptible d’obtenir davantage d’utilité dans l’équilibre anarchique, que si elle devait dépendre de sa propre production…. Tel serait le cas si les deux personnes se démarquaient l’une de l’autre par des capacités de production très différentes …. Si la position de production directe [d’autarcie] n’est pas supérieure à E au sens de Pareto, des droits de propriété clairs sur les biens produits directement ne pourront émerger de l’entente contractuelle idéale »p73
Mais si l’anarchie est pire que l’autarcie pour les deux individus, ceux ci ont intérêt à un accord afin de revenir artificiellement à l’autarcie. Ce ‘cessez le feu’ implique éventuellement une redistribution, compte tenu du pouvoir de négociation de chacun. Buchanan conclut :
« Notre analyse s’est attachée à la nature des avantages mutuels que produit un premier accord de désarmement, accompagné, le cas échéant, par des transferts unilatéraux de biens et de ressources. Toutes les parties gagnent à ce premier contrat global en ce qu’il permet l’élimination du gaspillage que constituent les dépenses de protection et de pillage »p75
Il reste cependant un problème à régler.
« […] le problème de l’exécution des ententes contractuelles doit être abordé de front. En ce qu’elle cherchera à maximiser son utilité, chaque personne trahira ses obligations contractuelles si elle croit que la trahison demeurera unilatérale »p76.
C’est pour cette raison que l’appel à une « agence de sécurité » est nécessaire.
« ils prévoiront, dans le cadre de leur contrat, un dispositif d’exécution des obligations… Le fait de faire respecter les droits de propriété… constitue un bien public [collectif] au sens moderne du terme »p78. « Une solution au problème pourrait consister en une entente entre toutes les personnes sur l’achat de ce genre de services auprès d’une institution ou d’un agent extérieur qui s’occupera des cas particuliers ou il faut faire respecter la loi et punir»(p79).
C’est cet agent extérieur que Buchanan appelle par la suite l’Etat.
Buchanan donne une fondation contractualiste à l’optimum de Pareto : Les deux individus tomberont d’accord sur des règles qui permettent des améliorations paretiennes :
- accord de désarmement qui permet à chacun d’améliorer sa position
- fixation de droits de propriété qui permet des échanges mutuellement avantageux.
- appel à un Etat qui fera respecter ces droits de propriété et assurera donc la pérennité de l’amélioration paretienne
Buchanan présente le schéma suivant :

Ainsi que l’écrit S.Freeman à propos des conceptions ‘hobbesiennes’ de Buchanan et de Gauthier :
« Un trait essentiel des conceptions fondées sur les intérêts est que chaque partie de l’accord doit y gagner quelque chose (ou du moins ne pas y perdre) par rapport à ce quelle aurait en l’absence d’accord ; une amélioration au sens de Pareto constitue alors la condition d’un tel accord » .
Comment le contrat constitutionnel s’impose aux individus réels
Comme tout contrat social « hypothétique », l’accord imaginé par Buchanan n’engage pas seulement les personnages de fiction qui le signent, mais il est réputé généralisable à toute l’humanité. Or cette généralisation ne va pas de soi.
Buchanan pose la question ainsi : « Mais les fils occupent maintenant la place de leurs pères dans la communauté, et ils ne se sentent plus eux-mêmes, moralement liés par le contrat »p90
En fait, il est difficile de croire que les individus présents dans la robinsonnade soient les « pères » de quelque individu réel que ce soit. D’ailleurs, Buchanan reconnaît que « Sur le plan historique, il est fort possible qu’il n’y ait jamais eu de stade constitutionnel comme tel »(p59).
Néanmoins, les ‘fils’ réels doivent quand même appliquer l’engagement conclu par ces pères imaginaires. La conséquence pratique de cette idée, c’est que l’ « Etat gendarme » embauché par les contractants fictifs, se passe du consentement des individus réels : « Comme tel, l’Etat juridique, l’Etat protecteur [de l’accord conclu] n’est pas « démocratique » si on entend par ce terme l’adhésion à un processus de choix collectif par voie de scrutin majoritaire ou non »p81.
Donc, finalement, les individus réels doivent respecter un accord, qualifié maintenant de ‘constitution’, parce qu’il a été conclu par des contractants qui n’ont comme souci que de s’empêcher mutuellement de piller leurs greniers.
De ce point de vue, on peut comparer Buchanan à Rawls.
Dans la ‘justice procédurale’ de Rawls, l’accord engage (selon Rawls) le genre humain, parce que les ‘partenaires’ de la position originelle sont ‘désintéressés’ (en d’autres termes, égoïstes), mais aussi parce que ces égoïstes sont ‘sous voile d’ignorance’ et, de ce fait, mis dans la position du spectateur impartial. Dans le ‘contrat constitutionnel’ de Buchanan, faute de voile d’ignorance, nous ne voyons pas pourquoi l’accord hypothétique engagerait le genre humain.
En revanche, nous constatons qu’il permet à Buchanan de découvrir le bien public (l’optimum) en mettant en scène des individus fictifs qui ne pensent qu’à leur propre intérêt. Les individus réels (les ‘fils’) n’ont plus, ensuite, qu’à obéir à l’Etat qui ‘protège’ ce bien public.
La méthode originale de Walras et Pareto
Il nous semble que, au moment ou ils déterminent, l’un le « maximum d’utilité » et l’autre le « maximum d’ophélimité pour la société », Walras et Pareto ne sont ni utilitaristes (et observateurs) ni contractualistes. Ils ne se rattachent donc pas à une des bornes de l’opposition tracée par Rawls. Malgré ce défaut d’ancrage dans le débat contemporain de philosophie et d’économie normative, il nous semble que leurs méthodes ne sont pas moins rigoureuses. Néanmoins, comme on peut déjà s’y attendre, le bien public y est déterminé à partir d’individus qui ne s’y intéressent pas. Nous traiterons de Walras, puis, beaucoup plus brièvement de Pareto.
Walras
Comparons le rôle respectif des individus et du théoricien, dans ce que l’on a appelé la ‘méthode de l’observation’ et la méthode du contrat social.
Dans la méthode de l’observation, les individus sont muets. C’est le théoricien qui définit seul, le bien public.
Dans la méthode du contrat social, c’est le contraire. Les individus parlent pour dicter en quelque sort le texte de leur accord au théoricien qui n’est que leur greffier.
La méthode de Walras nous semble intermédiaire à cet égard : les individus s’expriment, mais seulement à titre consultatif. Le théoricien en tire les conclusions.
D’abord, il nous semble utile de rappeler que Walras détermine l’équilibre général comme étant le bien public à deux endroits de son œuvre, et de deux manières très différentes.
« L’échange de deux marchandises entre elles »
Dés la première édition de ses « éléments d’économie politique pure » en 1874, Walras définit : le « maximum d’utilité ». Cette forme de bien public est proposée dans la « théorie de l’échange de deux marchandises entre elles ». On a déjà vu que Walras supposait d’abord, pour étudier les offres et les demandes, que les échangistes confiaient leur pouvoir d’offrir et de demander à des courtiers. Il suppose que les deux produits sont échangés, unité par unité. Après avoir présenté la « solution du problème de l’échange » dans la 7eme leçon, il traite dans la 8eme leçon le « théorème de l’utilité maxima des marchandises ».
Pour déterminer ce maximum, il observe l’évolution de la satisfaction des agents, alors que des unités supplémentaires sont échangées.
« On se rapprocherait du maximum de satisfaction en échangeant une certaine quantité de (A) contre une certaine quantité de (B) jusqu’à ce qu’on eut atteint la limite :
rb,1 = pbra,1…(EESp116)
Deux marchandises étant données sur le marché, la satisfaction maxima des besoins ou le maximum d’utilité effective a lieu, pour chaque porteur, lorsque le maximum des intensités des derniers besoins satisfait est égal au prix » (EEPp116)
A l’équilibre de l’échange, la satisfaction est maximum pour chaque échangiste. Donc l’équilibre réalise le bien public.
Il nous semble qu’ici, si le raisonnement de Walras est original, sa méthode ne l’est pas. Il énonce la norme en observant les comportements des agents, comme Dupuit le faisait lorsqu’il déterminait le « maximum d’utilité » en matière de travaux publics.
La « théorie de la propriété »
Plus tard, Walras va justifier à nouveau l’équilibre général comme définition du bien public, par une méthode tout à fait différente et beaucoup plus originale. Dans le langage de Walras, il s’agit de fonder le bien public non plus seulement sur le plan de l’intérêt mais également sur le plan de la justice.
La « théorie de la propriété » de Walras, a été éditée (initialement sous la forme d’un article) 22 ans après la « théorie de l’échange de deux marchandises entre elles » que l’on vient de citer.
Rappelons qu’en ce qui concerne la détermination de la justice et le fondement de l’Etat, Walras rejette le contractualisme.
« C’était l’idée des philosophes du XVIIIème siècle… que la société est un fait conventionnel et libre, et non un fait naturel et nécessaire. A ce point de vue, l’homme est un jour sorti de l’état de nature pour entrer dans l’état social, et cet état repose ainsi sur le contrat social. Les théoriciens de cette époque négligent de nous dire quel jour fut pris cet arrangement et dans quelles archives s’en trouve le texte »(EESp150)
Il se déclare en revanche, partisan du droit naturel
« Le droit naturel de l’individu » « Ce bon vieux droit naturel »
Il affirme donc tirer les principes de la justice, de la raison et de la nature humaine
« Il n’y a plus qu’à extraire tous les principes de la science par une série de jugements analytiques à priori, nécessaires comme en géométrie »(CESp164) « Voilà ce qu’est l’homme… Telle est la définition dont il s’agit de tirer ‘ à priori’ et rationnellement, la théorie de la société économique et morale »(CESp181)
Walras suit fidèlement ce programme pour arriver aux fameux « lemmes » de la « théorie de la propriété ». Celui qui nous intéresse est le lemme II (le plus connu) « Le propriétaire de cette chose est propriétaire du service de cette chose ». En effet, la démonstration de ce lemme repose sur une petite fable. Il s’agit du passage célèbre ou Walras compare « du point de vue de la justice » deux formes de troc.
- L’un, qu’il appelle « troc gossenien » (d’après l’économiste allemand Hermann Gossen) est une redistribution sous l’égide d’un despote omniscient.
- L’autre qu’il appelle le « troc jevonien » (d’après l’économiste anglais Stanley Jevons) est un échange marchand. Le « troc jevonien » reprend en fait « l’échange de deux marchandises entre elles », mais en le présentant de manière très différente. Nous ne somme plus (ou pas encore) sur le marché, mais dans une situation ou deux propriétaires affirment leurs valeurs morales. C’est le résultat de ce troc qui constitue le bien public selon Walras.
La situation imaginée par Walras est la suivante : Deux agents A et B sont mis en présence d’une sorte de meneur de jeu. A est doté en grain et B est doté en viande. Puis, un ‘troc’ s’opère, sous la direction ou le contrôle de l’arbitre.
Supposons comme Walras, pour les besoins de l’exposition, que les utilités soient mesurables. Voyons d’abord quelle serait la satisfaction des deux agents si chacun consommait sa dotation. En se servant des chiffres de Walras et des graphiques qu’il fournit, on parvient à peu près aux chiffres suivants pour les utilités marginales (on s’inspire des tableaux de A.Rebeyrol, que l’on reproduira dans un instant)

Les utilités marginales de A et de B pour les dotations initiales
(d’après les graphiques de Walras)
Si chacun consommait sa dotation, A qui est doté en grain serait donc presque rassasié de grain (UmA,g = 2) et aurait faim de viande (Um A,v = 16) , alors que B, qui est doté en viande, aurait au contraire faim de grain et serait plutôt rassasié en viande.
Le troc gossenien
« Le grain serait réparti entre A et B, de façon à ce qu’ils s’arrêtassent tous les deux à une rareté égale à 5 pour la viande ; et la viande serait répartie entre eux de façon à ce qu’ils s’arrêtassent tous les deux à une rareté égale à 10 »(EESp181)

(Rebeyrol 1999 p76 d’après les chiffres de Walras)
Le troc jevonien
« On essaye au hasard un prix du grain en viande, inverse du prix de la viande en grain. A ces prix proposé, chacun des troqueurs décide à la fois quelle quantité de sa marchandise il veut céder et quelle quantité de l’autre marchandise il veut acquérir » [mais à ce prix, les offres et les demandes ne sont pas forcément égales]. « En ce cas, on essaiera un autre prix du grain en viande, inverse d’un autre prix de la viande en grain » et ainsi de suite jusqu’à « l’égalité de la demande et de l’offre des deux marchandises. … à ce moment, le rapport des « raretés » des deux marchandises, égale au prix de l’une dans l’autre est le même chez chaque troqueur, le rapport des « raretés » des deux troqueurs est aussi le même pour chaque marchandise »(EESp180)
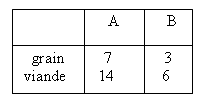
(Rebeyrol 1999 p76 d’après les chiffres de Walras)
l’insuffisance de l’observation
Que peut penser l’observateur de ces résultats ? Dans un cas comme dans l’autre, On peut parler d’une satisfaction maxima (de plus, ainsi que le fait remarquer A.Rebeyrol, les deux trocs sont des optimums de Pareto)
Avec le troc gossenien « la satisfaction des deux troqueurs pris ensemble est portée au maximum absolu » et avec le troc jevonien « en vertu de la condition de satisfaction maxima… le rapport des raretés est le même chez chaque troqueur »(pp180-181). Comment choisir entre ces deux formes de troc ? En faisant participer les agents.
La volonté des agents
C’est l’invocation du « droit naturel de propriété » qui va amener Walras à trancher en faveur du troc jevonien dont le résultat définira désormais le bien public.
Mais comment s’exprime t’il ce « droit naturel » ? Par la voix des agents.
Dans la « théorie de l’échange de deux marchandises entre elles, les agents étaient passifs. Tout au plus, l’économiste remarquait t’il que tel ou tel échange était « plus avantageux » ou « moins avantageux » pour les agents. C’est l’économiste qui déterminait pour eux, le « maximum d’utilité ».
Dans la « théorie de la propriété », dans le cas du «troc jevonien », aux prix proposés, « chaque troqueur décide à la fois quelle quantité de sa marchandise il veut céder, et quelle quantité de l’autre marchandise il veut acquérir »(EESp179, souligné par nous). A l’équilibre, chaque individu est volontaire pour échanger les mêmes quantités. De ce fait, le troc jevonien « s’effectue par la volonté de l’individu cherchant en toute liberté son avantage ».
Au contraire, « Dans le monde gossenien, B fait à A une concession volontaire ou forcée ». (Walras démontre en partant du résultat du troc jevonien, que le résultat du troc gossenien implique une redistribution). Or, « des concessions acceptables comme une politesse quand elles sont volontaires, devraient être repoussée comme une humiliation si elles étaient imposées par la loi ». Walras énonce ensuite sa devise, qui implicitement est aussi celle des participants du troc : « Tout notre dû, rien de moins, rien de plus ».
De notre point de vue, ceci signifie que :
1) Il faut supposer que les agents qui doivent énoncer la norme sont égoïstes.
2) Les agents doivent énoncer haut et fort, ce pour quoi ils sont volontaires.
3) Le bien public correspond à la morale de l’histoire énoncée par l’économiste
On remarque que les individus ne tombent pas formellement d’accord sur la règle, et qu’ils fondent encore moins d’Etat, ce qui différencie cette petite fable avec un contrat social. Cependant, cette fable permettra de fonder l’Etat en raison, comme celui qui fait respecter la règle ainsi définie.
Plus exactement, le ‘troc jevonien’ nous semble être une sorte d’expérience mentale à l’usage du législateur. On peut s’inspirer de ce que le philosophe Jon Elster appelle « le kantisme de tous les jours ». Elster prend l’image des papiers gras. L’individu moral, au moment de jeter un papier gras, imagine dans quel état seraient les rues, si tout le monde faisait comme lui. L’évocation de cette scène virtuelle l’amène à prendre la bonne décision : ne pas jeter le papier gras.
Le « troc jevonien » est, de la même manière, une image virtuelle que le bon gouvernement (ou le gouvernement juste), idéalement savant et bienveillant, projette dans sa tête, en imagination, avant de prendre une décision. Rappelons que Walras dit que le droit du gouvernement ne procède pas du tout « des individus dont il se compose ». Il vient en effet d’autres individus : de ceux qu’il imagine dans la « légende » - pour reprendre le terme d’A.Rebeyrol - du troc jevonien. Ces êtres fictifs sont volontaires pour accepter une règle que, par généralisation, l’Etat appliquera aux individus « dont il se compose ». On pourrait, dans le cas d’Elster, comme de Walras, parler d’un idéalisme scénarisé : la projection mentale d’une situation imaginaire (tout le monde jette des papiers gras, deux ‘troqueurs’ redistribuent des biens), indique quelle est l’action juste (pour l’individu chez Elster, pour l’Etat éclairé chez Walras)
Pareto
L’optimum de Pareto n’est pas ‘économiste’ dans son principe et il est seulement une propriété de certains états sociaux. C’est sa ‘lecture’ par Pareto lui-même que l’on présente ici.
Il nous semble cependant que la manière dont Pareto présente son « maximum d’ophélimité pour la collectivité » n’est pas sans rapport avec la manière dont Walras présente le « second lemme » de la « théorie de la propriété ».
- Pareto écrit :
« Nous nommerons P, les mouvements qui sont tels qu’en agissant dans l’intérêt de certains individus, on nuit nécessairement à d’autres…. Nous nommerons Q, les mouvements tels que l’on agit dans l’intérêt ou au détriment de tous les individus sans exception… Quand la collectivité se trouve en un point Q dont elle peut s’éloigner à l’avantage de tous les individus, en leur procurant à tous de plus grandes jouissances, il est manifeste qu’au point de vue économique et si on ne recherche que l’avantage de tous les individus qui composent la collectivité, il convient de ne pas s’arrêter en un tel point, mais de continuer à s’en éloigner, tant que c’est à l’avantage de tous. Lorsque ensuite, on arrive à un point P ou cela n’est plus possible, il faut, pour s’arrêter ou pour continuer, recourir à d’autres considérations, étrangères à l’économie »(Traité de sociologie générale.pp1338-9)
On lit que pour Pareto, il existe une instance « qui ne recherche que l’avantage de tous les individus ». Juste avant le passage que nous avons cité, Pareto imagine une « autorité publique » supposée impartiale et bienveillante. « Cela a lieu bien rarement, mais il n’est pas nécessaire de nous préoccuper ici de ce fait, puisque nous considérons non pas un cas réel et concret, mais un cas théorique et hypothétique ». Il nous semble que l’on est proche de l’expérience mentale à l’usage de l’Etat éclairé qu’il nous avait semblé déceler dans la méthode de Walras.
En ce qui concerne les objectifs des individus, il est bien connu depuis le célèbre article de Sen « The impossible of a paretian liberal »1970, que l’optimum est compatible avec la présence d’agents paternalistes. Cependant, dans l’esprit de Pareto, il est clair que les individus sont sensés ne s’intéresser qu’à leur bien être personnel : « Chaque individu, dans la mesure ou il agit logiquement, s’efforce d’obtenir le maximum d’utilité individuelle »(s.p1342). Chaque individu recherche son propre intérêt, seule l’autorité publique recherche le bien être.
Cependant, ainsi que nous le fait remarquer Jean Cartelier « l’intervention d’un législateur bienveillant pour définir l’optimum paraît assez différente de ce qu’elle est [chez les économistes précédemment mentionnés]. Certes, il faut qu’il existe un regard extérieur sur la société pour produire une telle référence, celui de l’auteur-théoricien ; mais, à ce stade, il n’est pas nécessaire que l’économiste entame le dialogue avec les individus, ni qu’il intervienne de quelque manière que ce soit ». L’ « autorité publique » est donc logiquement inutile à la définition de l’optimum.
Conclusion
Les économistes utilisent donc des méthodes variées pour déterminer le bien public, et cependant, ces méthodes présentent quelques constantes.
Si on accepte la référence de Walras au droit naturel, on peut dire que les méthodes des économistes sont les mêmes que celles des philosophes : observation, contrat social, et raisonnement ‘à priori’. On a vu que ces méthodes pouvaient servir à justifier des formes du bien public déjà connues par ailleurs.
Les constantes, elles, nous semblent les suivantes.
D’abord, la détermination du bien public se fait toujours à partir des désirs des individus, que ce soient ceux des individus pris dans n’importe quelle situation, ou celle d‘individus mis dans une situation ‘de laboratoire’, par exemple les Robinsons de Buchanan, ou les troqueurs de Walras.
Et ensuite, ainsi qu’on l’avait déjà remarqué au départ, le bien public, quel que soit sa justification a toujours un contenu. Il nous semble que cela n’est pas toujours vrai en philosophie politique. Par exemple la règle selon laquelle il faut toujours tenir ses promesses, une règle libérale du « laissez faire » par principe, ne préjugent en rien du résultat auquel la société aboutira.
Ce qui nous semble en fait le plus original, c’est justement cette réunion entre la référence aux individus et un objectif social déterminé. A priori, ces deux aspects sont contradictoires, car la référence aux individus, si elle peut fonder des règles de morale individuelle (comme le ‘kantisme de tous les jours’ d’Elster), appelle à priori, quand il s’agit de fonder des règles collectives, à organiser simplement la liberté de ces individus par des règles abstraites. Par exemple, on posera comme principe le suffrage universel ou l’échange volontaire, quoi qu’il puisse en découler (puisqu’on ne peut pas juger ce qui en découle).
En donnant aux règles collectives un contenu, il nous semble que les économistes au sens large (en incluant Bentham et Rawls) ont véritablement inventé l’éthique sociale : il y aurait des buts que les collectivités doivent s’assigner, tout comme il aurait des buts que les individus doivent s’assigner.
S2 : Pourquoi la cité idéale des économistes n’est pas une secte :
justice et responsabilité individuelle chez Walras
On a vu que les économistes déterminaient rationnellement une éthique sociale, c’est à dire un but que ‘la collectivité’ doit s’assigner.
Dans ces conditions, pourquoi les économistes ne se transforment ils pas en propagandistes en convainquant les individus d’adhérer à ce but ? Pourquoi nos rues ne sont elles pas ornées de fresques représentant Walras, Pareto et Harsanyi accompagnées de slogans tels que « Le bon citoyen se rend chaque jour sur les marchés organisés », ou bien « Choisis toujours une issue optimale » ou encore « Chacun de nous doit agir pour maximiser l’utilité totale ». L’argument instrumental d’Adam Smith, la « main invisible », n’est plus convaincante face à l’équivalence théorique de la concurrence entrepreneuriale et du socialisme de marché ou face au dilemme du prisonnier.
Si la cité idéale de l’économiste n’est pas une version rationnelle du régime maoïste, ce n’est pas non plus parce que les économistes sont démocrates ni parce qu’ils n’aiment pas la morale. On verra dans le chapitre 5 que la justice prime pour eux sur la loi de la majorité, et on verra dans le chapitre 6 que certains d’entre eux sont partisans d’une éthique fort rigoureuse.
Si la cité idéale de l’économiste n’est pas une secte, nous pensons que c’est justement parce que les économistes sont des moralistes. On va voir que chez Walras, l’idéal de justice se combine avec un idéal moral de responsabilité individuelle et que c’est ce second idéal qui est incompatible avec la transformation du bien public de l’économiste en éthique individuelle.
On peut définir le principe de responsabilité individuelle en disant que chaque individu doit subir seul les conséquences bonnes ou mauvaises de ses actes.
Or ce principe peut être mis à mal de deux manières.
- Soit, volontairement, quand les individus s’occupent des affaires de tous et pas seulement de leurs propres affaires. En effet, si les individus agissent en fonction de ce qu’ils pensent être le bien public, ils agiront au contraire de manière à ce que les autres ‘bénéficient’ des conséquences de leurs actes, et ces autres ne devront donc plus leur position seulement à eux mêmes.
- Soit involontairement, quand les individus émettent des effets externes positifs ou négatifs, qui retentissent sur l’utilité des autres ; auquel cas de nouveau, ces autres ne doivent pas leur position seulement à eux mêmes.
L’idée de responsabilité englobe donc l’idée que les individus ne s’occupent que de leur propre intérêt. Or ce souci de responsabilité occupe une grande place dans les préoccupations de Walras, presque aussi grande que son idéal de justice. Si grande même que :
- dans l’économie de production , il confond la responsabilité et la justice alors qu’en toute rigueur l’échange juste ne respecte pas toujours la responsabilité individuelle.
- dans l’économie de capitalisation, il ajoute la responsabilité à la justice pour définir l’objectif social à atteindre.
C’est ce que l’on va tenter de montrer maintenant.
Equilibre général et responsabilité individuelle chez Walras
On a déjà vu que Walras déterminait une norme de bien public de bien être et de justice, qu’il tirait à la fois de l’observation des agents (le maximum d’utilité) et d’une consultation des agents (le troc jevonien).
Mais Walras adhère également avec vigueur à l’idée de responsabilité individuelle. Il écrit par exemple « si l’individu veut la liberté, il doit accepter la responsabilité »EAp261. Il dénonce sur cette base « l’assurance contre les accidents professionnels… collective et obligatoire »p260. Il s’indigne contre l’idée d’un Etat providence :
« Mais quant à laisser les hommes travailler comme ils l’entendent [….] à charge pour l’Etat de leur garantir un salaire minimum ou de les nourrir, eux, leurs femmes et leurs enfants. [C]’est un système qui doit être séduisant, puisque, depuis tantôt quarante ans, je le vois se reproduire avec un succès constant […. Mais] Je suis convaincu que les races [Walras entend par là les nations] appelées à renouveler la face du monde en y faisant régner la justice et l’ordre, sont celles qui […] montrent qu’elles sont vraiment des races d’hommes en manifestant une soif égale de liberté et de responsabilité… »(p261)
Walras a très bien vu que l’Etat providence est incompatible avec le principe de responsabilité parce qu’il opère une redistribution à la fois obligatoire (dans son principe) et accidentelle (dans ses transferts).
Walras lui oppose donc son « idéal social » :
Là, les hommes se retrouveraient dans la complexité de l’Etat industriel et commercial, tels qu’ils étaient dans la simplicité de l’état sauvage. De même qu’ils rentraient chez eux ayant plus ou moins diligemment et adroitement chassé dans la forêt commune, de même, la richesse serait à la fois la conséquence et la récompense du travail et de l’épargne, la pauvreté serait la conséquence et le châtiment de la paresse et de la dissipation »EESp404
Mais qu’en est-il vraiment de la responsabilité dans cette société « idéale » ?
Il nous semble qu’il faut distinguer deux cas, que d’ailleurs Walras distingue dans la phrase par les mots de « travail » et d’ « épargne » :
- l’économie de production ou les individus sont dotés de capitaux naturels.
- l’économie de capitalisation, où les individus peuvent acquérir et accumuler des capitaux artificiels.
Equilibre et responsabilité : l’économie de production
Pour Walras, les aptitudes des individus sont des données de la nature, et nul ne peut en être tenu pour responsable que la nature elle-même. Walras illustre cette idée par la boutade suivante :
« Les gens qui ont le nez mal fait sont-ils fondés à réclamer contre ceux qui l’ont bien fait ? En aucune façon, vu que c’est le hasard qui décide de la naissance, et qu’il n’y a pas à réclamer contre le hasard [...]et voilà comment chaque nation a droit au territoire qu’elle habite. Qu’il y fasse chaud ou froid, c’est tant pis ou tant mieux pour elle »(CESp253 cité par Rouge-Pullon 2000p6).
Maintenant, voici comment Walras présente le principe de responsabilité dans sa « Théorie de la propriété », immédiatement après le ‘troc jevonien’ qui, comme on l’a vu, sert à déterminer la norme ‘de justice’ économique :
« Supposez, si vous voulez, l’idéal social réalisé de la façon la plus complète, la justice et l’ordre régnant définitivement... personne n’est plus malheureux que par la faute de la nature ou de sa propre faute »EESp188.
Walras parle aussi de « l’homme… libre et responsable, ayant à subir… les conséquences bonnes ou mauvaises de son activité ou de sa paresse, de sa vertu ou de ses vices » (Cours ; p153)
Cependant, la « théorie de la production » de Walras, ne réalise pas forcément ce programme ‘responsabiliste’. On va montrer par un exemple, que, si les productivités des individus sont déterminées une fois pour toutes, il peut advenir qu’un travailleur et qu’un paresseux consomment autant l’un que l’autre. Le « maximum d’utilité » et la justice distributive sont atteints, mais pas la morale de l’effort impliquée par l’idée de responsabilité.
une situation fictive
Imaginons deux Robinsons, chacun ayant défriché un arpent, dans la « forêt commune ».
Le premier, fainéant, est un paresseux. Il ne sait produire que du bien A (des ananas).
Le second, vaillant, est un travailleur. Il ne sait produire que du bien B (des bananes).
(on a pris le cas limite ou l’un des coefficients de production est nul pour chacun des deux agents).
Fainéant et vaillant aiment également les ananas et les bananes. L’un comme l’autre aiment aussi se reposer, mais fainéant beaucoup plus que vaillant.
Afin de pouvoir profiter des bienfaits de l’échange, fainéant et vaillant décident de se rencontrer et d’organiser un tâtonnement selon les règles de la justice dans l’échange. On suppose que le bien A (les ananas produits par fainéant) est choisi comme numéraire. Lors de ce tâtonnement, pour chaque prix crié par le ‘commissaire-priseur’, chacun des deux agents prend une décision de production et de loisir. A l’équilibre, ces plans sont compatibles et chacun consomme des deux biens et du loisir.
Les coefficients de production sont de 1 : fainéant fabrique 1 unité de A en une heure (ou en une unité de temps), et vaillant fabrique 1 unité de B en une heure.
a et b représentent les quantités consommées de biens A et B, et l représente le temps dépensé en loisir.
On suppose que fainéant et vaillant disposent du même temps disponible T avant de se rendre au marché.
Fainéant (noté f) peut utiliser T, soit à fabriquer du A pour sa propre consommation, soit à fabriquer du A afin de l’échanger contre du B au prix pb , soit à se promener.
Pour fainéant : T = af + bfpb + lf
Vaillant (noté v) peut utiliser T, soit à fabriquer du B pour sa propre consommation, soit à fabriquer du B afin de l’échanger contre du A au prix 1/pb , soit à se promener.
Pour vaillant : T = bv + av/pb + lv
L’utilité de fainéant (producteur d’ananas)
On exprime la paresse de fainéant en supposant qu’il retire du loisir une utilité ‘double’ de celle qu’il retire de la consommation.
Uf = af1/2bf1/2 +2lf1/2

La morale de cette histoire est donc immorale. L’échange marchand permet au paresseux de consommer autant que le travailleur tout en travaillant beaucoup moins. Si on considère que les dotations initiales sont justes (et elles le sont, à priori, puisqu’elles sont données par la nature), comme l’échange a lieu au prix d’équilibre, les consommations sont à la fois justes et efficaces. Mais cela n’empêche pas que la morale de la responsabilité n’est pas respectée. D’une manière générale, il est illogique de se déclarer à la fois partisan du marché et partisan de la responsabilité. Il est donc à priori surprenant que Walras veule les deux, mais ce n’est pas sans raison et on verra avec Hayek ce qui est important dans la ‘responsabilité’.
Equilibre et responsabilité : l’économie de capitalisation
Rappelons que, dans ses « éléments d’économie politique pure », Walras, après sa « théorie de l’échange… » puis sa « théorie de la production », présente une « théorie de la capitalisation et du crédit ». Ce titre est en partie trompeur, car, dans le modèle de Walras, il n’y a en fait pas de crédit, ni même de monnaie. Il s’agit donc en fait d’une ‘théorie de la capitalisation’.
La « capitalisation », c’est l’investissement. Mais cet investissement, dans le modèle de Walras, est réalisé, non pas par les entreprises, mais par les ménages. En fait, tous les capitaux sont possédés par les ménages, et les entreprises doivent, à chaque période, les louer aux capitalistes (les propriétaires de ces capitaux), comme elles doivent louer les bras des travailleurs. De ce fait, chaque « espèce » de capital a un prix de location. Dans les notations de Walras, si (K) désigne, par exemple, un tracteur, (k) désigne le « service » rendu par le tracteur, c’est à dire le service qu’il rend à l’entrepreneur d’agriculture qui le loue.
Donc, les entrepreneurs, en combinant ces services rendus par les capitaux, avec des travaux, fabriquent des produits qu’ils offriront sur le marché.
Les ménages peuvent détenir les capitaux, soit concrètement, soit sous forme d’actions : les ménages louent alors ensemble, le capital qu’ils détiennent collectivement.
Capitalisation et responsabilité
Voici ce qu’écrit Walras :
« Nous demandons si l’inégalité n’a pas ses droits, et si c’est une chose moins opposée à la justice, alors que j’ai été toute ma vie un producteur actif et économe, qu’on me ramène, sur mes vieux jours, au niveau de consommation d’un fainéant et d’un dissipateur »CESp215
Il nous semble que le mot de « justice » est ici mal placé. En effet, pour Walras, une distribution juste est celle qui résulte d’un échange juste (‘le troc jevonien’) sur la base de dotations initiales elles-mêmes justes. Il n’y a donc pas à comparer les consommations des uns et des autres : elles sont justes car elles résultent d’une procédure juste, pas parce que la distribution finale serait telle ou telle. Walras parle ici, en fait, du principe de responsabilité.
Ce principe, dans une économie de capitalisation est parfaitement illustré par la fable « la cigale et la fourmi » : La cigale subit les conséquences de sa vie de loisir, et la fourmi profite du capital qu’elle a patiemment accumulé.
C’est au nom de ce principe que Walras s’oppose à la redistribution « les individus empiétant sur les fonctions de l’Etat…prononçant sur les contestations des uns et des autres, reprenant à Pierre ce qu’il a pour le rendre à Paul »(CESp214) En effet, la redistribution sociale ne permet pas à chacun d’avoir selon ses « mérites » et ses efforts d’épargne.
Mais qu’en est-il dans le système de Walras ?
Chacun connaît l’expression ‘économie de casino’. Les données historiques montrent que, quand les individus achètent des actions pour financer leur retraite, leur niveau de vie, en tant que retraités, dépend avant tout des cours de la bourse qui dépendent eux-mêmes des actions de tous. A priori, le capitalisme populaire est donc l’enfer du principe de responsabilité. Walras lui-même parle avec réprobation, des « jeux de la bourse ».
Or, le système de Walras est justement un ‘capitalisme populaire’. Comment Walras va-t-il parvenir à concilier la ‘capitalisation’ individuelle et le principe de responsabilité ?
Le problème réside dans les prévisions erronées des individus sur ce que peuvent leur rapporter les différents capitaux : c’est cette méconnaissance de l’avenir qui transforme le ‘capitalisme populaire’ en jeu de hasard. Ce sont donc les prévisions qu’il faudra neutraliser pour moraliser la capitalisation
Les prévisions à l’Etat de nature
Retournons d’abord à l’état de nature. Dans la « forêt commune » chaque Robinson a installé son campement en autarcie, et se nourrit des réserves que son abstinence passée lui a permis d’accumuler.
Imaginons qu’une tempête s’abat inopinément sur la forêt primitive des Robinsons. Aveugle, elle frappe inégalement les individus. Les réserves des uns sont détruites, celles des autres préservées.
La distribution qui en résulte est cependant conforme au principe de responsabilité car les dégâts subis par les uns relèvent de « la faute de la nature » et non de la faute des autres.
Voyons maintenant un cas un peu différent :
La tempête va s’abattre, mais elle s’annonce (le ciel s’obscurcit…). Les producteurs autarciques réagissent différemment les uns des autres. Les uns prévoyant des rafales de vent, bâchent leurs champs. Les autres, prévoyant des inondations, mettent leur récolte au grenier. Puis la tempête s’abat, plus désastreuse pour ceux qui avaient fait les mauvaises prévisions.
La distribution qui en résulte est-elle encore conforme au principe de responsabilité ?
Oui, car chacun confronte ses talents naturels de prévision avec les forces de la nature. Les malheurs des uns ne sont en aucune manière, la conséquence des actions des autres. C’est la raison pour laquelle, quoi qu’il arrive dans l’état de nature, le principe de responsabilité y est respecté.
Le passage à l’état social
A l’état social, et plus exactement, dans la succession des équilibres marchands imaginés par Walras, dans sa « théorie de la capitalisation », l’avenir, et la vision qu’en ont les individus importe également. D’abord, parce que le passage à l’état social ne fait pas disparaître l’incertitude : la tempête peut également s’abattre sur la société. Et ensuite, surtout, parce que les individus peuvent anticiper des données inexistantes chez les Robinsons : les prix.
Il faut voir ce que devient – en société – le principe de responsabilité, du fait que les agents peuvent prévoir (les états de la nature), et du fait qu’ils peuvent anticiper (les prix)
L’incertitude à l’état social
Supposons, pour séparer les deux questions, que tous les agents forment des anticipations rationnelles : Pour chaque état de la nature, les agents savent quels seront les prix d’équilibre. Mais, les agents n’étant pas devins, ils ont des distributions de probabilité subjectives sur l’occurrence des divers états de la nature.
Imaginons deux capitalistes ou deux actionnaires i et j.
i, qui croit qu’il va pleuvoir aux périodes suivantes, achète des parts dans une fabrique de parapluie.
j, qui croit qu’il va faire beau, achète des parts dans une fabrique de parasols.
Aux périodes suivantes, il fait beau. i ne touche aucun dividende, au contraire de j qui peut consommer largement. Le principe de responsabilité a-t-il été respecté ?
Il l’a été, ni plus ni moins que dans l’échange des ananas et des bananes. j n’est pas responsable des malheurs de i, mais en revanche, les revenus de i et de j sont influencés par les comportements et donc les prix de marché (parfaitement anticipés) des autres individus. Le fait que les prévisions de i et de j divergent, n’ajoute, en lui-même, pas de nouvel accroc au principe.
Les anticipations à l’état social
Supposons maintenant qu’il n’y a pas d’incertitude : l’état du ciel, dans le futur, est parfaitement prévu. Mais, en revanche, les anticipations (de prix) des agents ne sont pas rationnelles, et chacun a les sienne. Cette hypothèse semble assez ‘naturelle’. En effet :
- D’abord, un agent ne connaît pas les préférences, et partant, les fonctions d’offre et de demande des autres agents.
- Ensuite, même s’il les connaissait, il serait incapable de calculer la ‘solution théorique’ : les prix d’équilibre.
De fait, pour Walras « en ce qui touche les variations attendues [des prix des actifs] les appréciations différent d’individu à individu »(EPp435)
Imaginons donc de nouveau deux capitalistes i et j.
i, qui pense que les sports d’hiver vont connaître une vogue, achète les actions d’une station de montagne.
j, qui pense que la côte attirera le tourisme hivernal, achète des actions de la compagnie PLM. Dans les périodes suivantes, les oisifs se détournent des sommets et se répandent sur la riviera. i est ruiné, j prospère. Le principe de responsabilité est-il respecté ?
Deux fois non :
D’abord, comme dans le cas précédent, parce que les décisions des touristes influent sur les prix d’équilibre
Et ensuite, et ceci est nouveau, parce que ces décisions ont dû être anticipées. En effet, alors qu’une prévision (des états de la nature) est un jeu entre l’individu et la nature, les anticipations (de prix) sont un jeu entre l’individu et les autres. Si i est ruiné, ce n’est pas « de sa faute et de la faute de la nature », c’est de sa faute et de la faute de ceux dont il a dû anticiper les comportements.
Donc, quand les anticipations ne sont pas unanimes, et pour reprendre la phrase de Walras, celui qui a été toute sa vie « actif et économe » peut se retrouver au niveau de consommation de l’ « oisif et dissipateur », pour peu qu’il ait ‘parié’ sur les mauvais capitaux (mal anticipé leurs prix)
La « théorie de la capitalisation » et le sauvetage de la responsabilité
Laissons de côté l’incertitude. En effet, Walras n’en parle pas, et de plus, on a vu qu’elle n’ajoutait rien au ‘défaut’ du marché, sous le rapport de la responsabilité.
Le problème est maintenant très simple dans son principe : comment faire régner le principe de responsabilité individuelle, alors que les anticipations (des prix) ne sont pas unanimes
Pour faire régner la responsabilité, pour restreindre les inégalités de patrimoines aux inégalités d’épargne, c’est à dire de talents naturels et d’efforts, il faudrait, en principe, qu’il n’y ait qu’une seule sorte de capital. S’il n’y a qu’un seul produit d’épargne, les noisettes par exemple, la valeur du patrimoine de chacun est bien proportionnelle à la valeur de son épargne : Si à la période t, i achète pour 100$ de noisettes, et j pour 200$, même si le ‘cours de la noisette’ est ensuite divisé par 2, et si les patrimoines respectifs tombent à 50$ et à 100$ respectivement, la morale est respectée.
C’est l’équivalent de cet unique capital, que Walras va inventer dans sa « théorie de la capitalisation », et réinventer sous une autre forme dans son « économie appliquée ».
Avant d’en venir à la solution de Walras, il est nécessaire de faire le lien entre l’immoralité potentielle de la capitalisation, et un comportement économique : la spéculation.
Spéculer sur des capitaux mobiliers, c’est acheter des capitaux afin de les revendre avec bénéfice. Plus précisément, c’est acheter le capital dont on pense savoir, mieux que le public, quel sera son prix futur. En un mot, spéculer, c’est donc utiliser l’immoralité potentielle du capitalisme (du point de vue de la responsabilité) à son profit. Moraliser la spéculation, c’est aussi éteindre le désir de spéculation, en supprimant son aliment : la diversité des capitaux.
Tout le monde spécule : ce qu’aurait pu être la « théorie de la capitalisation »
Notre but est maintenant de montrer que, si la « théorie de la capitalisation » de Walras, est tellement différente de sa « théorie de la production », c’est parce que Walras veut que le principe de responsabilité individuelle y soit respecté.
On va donc esquisser ce qu’aurait été une théorie de la capitalisation dans la droite ligne de la « théorie de la production », et constater qu’une telle organisation aurait conduit à une distribution immorale.
Rappelons brièvement le cadre de la « théorie de la production »
Cette « théorie » modélise une économie séquentielle, composée d’équilibres temporaires ‘isolés’ par l’absence de marchés à terme. A intervalle régulier, chaque « semaine », pour reprendre la célèbre image de Hicks, tous les agents, c’est à dire les ménages et les entrepreneurs, se retrouvent sur le marché. Il est plus simple d’imaginer que ces agents se réunissent autour d’un « commissaire priseur » qui enregistre les offres et les demandes, et modifie les prix pour les amener à l’équilibre général, et qui autorise alors les transactions.
Sur le marché, les ménages et les entrepreneurs se font face :
Les ménages offrent des « services producteurs », c’est à dire qu’ils louent leurs bras et leurs capitaux mobiliers, et demandent, en échange, des « produits consommables », c’est à dire des biens de consommations, fabriqués par les entreprises, à partir de ces services.
Les entrepreneurs eux, louent les bras et les capitaux des ménages. Ils offrent, en échange, les produits consommables.
Il existe un marché pour chaque « espèce » de travail et de capital, et pour chaque « espèce » de produit consommable.
L’organisation des échanges se fait en deux étapes.
Le tâtonnement On ne reformulera pas les équations de Walras et leur « résolution pratique ». Rappelons simplement qu’une instance non spécifiée qui sera appelée plus tard le « commissaire priseur » modifie les prix des services producteurs et les prix des produits consommables, jusqu’à ce que les offres et les demandes soit égales sur tous les marchés. C’est l’ « équilibre général ». Les offres et les demandes, qui étaient jusqu’ici virtuelles, deviennent alors réelles, et les échanges peuvent effectivement avoir lieu.
Les « livraisons réciproques de services et de produits »
C’est la seconde étape, que Walras présente d’une manière ‘littéraire’ :
« après les tâtonnements préliminaires faits sur bons, l’équilibre une fois établi en principe, la livraison des services commencera immédiatement, et continuera d’une façon déterminée pendant la période de temps considérée… la livraison des produits commencera de même immédiatement et continuera d’une façon déterminée pendant la même période »(Epp441).
La « théorie de la production » représente une économie sans monnaie et centralisée. Le plus simple est d’imaginer qu’il y a des ateliers et des magasins. Au fur et à mesure que la production s’effectue, chaque ménage se rend dans les magasins pour se faire livrer les marchandises qu’il a commandées à l’équilibre. Cet étalement des livraisons dans le temps reflète le fait que l’économie de Walras fonctionne entièrement en ‘flux tendus’ : on vend d’abord et on fabrique ensuite.
Maintenant, pour transformer cette économie de production en économie de capitalisation, il faudrait et il suffirait d’ajouter des capitaux à la liste de produits criés par le « commissaire priseur », lors de l’étape du tâtonnement, et éventuellement fabriquée par les entrepreneurs, si leur prix d’équilibre se révèle positif.
Les ménages dont le revenu excède la consommation (pour parler comme Walras) achèteraient donc, avec leur budget, et s’ils le souhaitent, des « produits capitaux » en plus des « produits consommables
Certains entrepreneurs eux, fabriqueraient ces produits capitaux, et les offriraient aux ménages.
Lors du tâtonnement, le commissaire-priseur « crierait » les prix de ces capitaux (ou des actions qui les représentent) comme il crie les prix des services consommables.
Lors des « livraisons réciproques », les capitalistes, à titre individuel ou en tant qu’actionnaires, se feraient livrer les capitaux comme les produits consommables. Celui qui a acheté une bétonneuse, irait la chercher au magasin, et celui qui a acheté une part d’une aciérie, se verrait remettre ses actions, au moment ou l’aciérie serait construite.
La présence de capitaux ne modifie donc pas les équations de la « théorie de la production », puisque les ménages demandent les capitaux avec, et au même titre que les produits consommables.
Dans une économie comme celle ci, tous les ménages spéculeraient : chacun demanderait l’ « espèce » de capital qui lui parait la plus prometteuse, en termes de revenus futurs. Par exemple, si je pense que les vacanciers vont prendre goût aux voyages, j’achèterai un avion de ligne (si mes moyens me le permettent) ou des parts dans une flotte d’avions de ligne.
Dans une telle économie, si les anticipations étaient unanimes (parfaites ou erronées), il existerait un unique taux de rendement interne des différents capitaux. De ce fait, à l’équilibre, il serait indifférent à un agent d’acheter tel ou tel capital.
Et, si les anticipations « diffèrent d’individu à individu », alors il n’y aura pas de taux unique, et, bien sur, la ‘morale’ de responsabilité individuelle ne sera pas respectée. Les revenus des uns et des autres, dépendront du hasard et de leur ‘flair’ spéculatif.
Personne ne spécule : La « théorie de la capitalisation »
On peut résumer la « théorie de la capitalisation » de Walras, à partir de la 4eme édition des « éléments » en disant qu’il s’agit d’un capitalisme dans lequel la spéculation est interdite.
Le tâtonnement
Les ménages ne demandent plus de capitaux, mais seulement de la « marchandise E » c’est à dire de la rente perpétuelle. Ce n’est pas que les ménages ne veuillent pas acheter des capitaux : au contraire, dans son « économie appliquée », Walras se désole que le « public des capitalistes » se rue sur les actions à l’émission. C’est tout simplement que le « commissaire priseur » ne « crie » plus de prix de vente des capitaux, mais seulement des prix de revient. Les entrepreneurs peuvent donc toujours en offrir, mais les ménages ne peuvent plus en demander. Les ménages qui veulent épargner doivent donc, d’accord ou pas d’accord, se rabattre sur la « marchandise E », dont le commissaire-priseur crie le taux de rendement.
Le système est le suivant : chaque unité de E rapporte une unité de numéraire par an. Le prix de E est l’inverse du « taux de revenu net » i crié par le commissaire-priseur. Si par exemple il ‘crie’ i = 5%, les ménages savent que, pour recevoir une unité de numéraire par « semaine » à partir de la « semaine » prochaine, ils doivent payer 20 unités de numéraire aujourd’hui. Un ménage prêt à payer 40 aujourd’hui, pour recevoir 2 par semaine, à partir de la semaine prochaine, demandera donc 2 unités de E.
Dans le langage de Walras, il faut « imaginer une marchandise (E) consistant en un ‘revenu net perpétuel’ dont le prix pe = 1/i et la quantité demandée de s’exprimant en unités de numéraire(EAp393). William Jaffé, le traducteur et éditeur de Walras explique en note « Chaque unité de E consiste en une unité de numéraire per annum, payable à perpétuité »(p849)
On remarque que cette organisation ‘neutralise’ les anticipations : quoique pense tel ou tel individu des dividendes futurs des aciéries ou des compagnies maritimes, et qu’il ait confiance ou pas dans la proclamation du « commissaire-priseur » selon laquelle une unité de E lui apportera i à chaque période jusqu’à la fin des temps, son seul choix est d’épargner (d’acheter du E) ou non.
Cette organisation est la traduction rigoureuse de l’ « économie appliquée » dans laquelle Walras s’emporte contre les boursicoteurs :
« Nous eussions aimé ces individus [les capitalistes qui achètent des actions à l’émission] renoncer à ces opérations, sinon par moralité ou par mépris d’un gain obtenu sans travail, du moins par intelligence…. Mais puisque, paraît-il, le moment n’est pas encore venu où les mœurs se passeront du secours des lois, nous consentons volontiers à ce que les portes de la bourse soient fermées à ceux qui n’ont rien à y faire »(EAp393)
L’équilibre
A l’équilibre de la capitalisation, comme à l’équilibre de la production, les quantités offertes et les quantités demandées sont les mêmes sur tous les marchés.
En ce qui concerne le marché du capital, les conditions d’équilibre sont les suivantes : (on suppose qu’il n’y a que deux « espèces de capitaux » (K) et (K’), par exemple, les camions et les tracteurs)
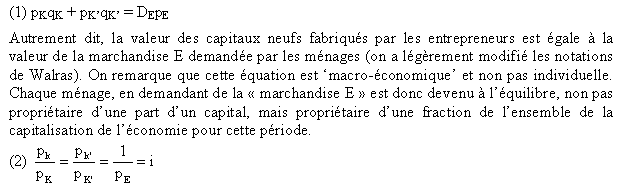
(où pk et pk’ représentent les prix courants de location des capitaux (par exemple, des camions et des tracteurs que, dans le système de Walras, leurs propriétaires « capitalistes » louent à chaque période aux entrepreneurs.)
Autrement dit, le rapport entre le prix courant de location de chaque capital et son coût de production, est l’inverse du prix de la ‘marchandise E’. Puisqu’une unité de E est censée rapporter un, ceci signifie que le rendement ‘crié’ de la marchandise E est égal au taux de rendement courant de chacun des capitaux neufs pris individuellement. Walras appelle ce taux de rendement, le « taux de revenu net » et le note i. (malgré cette notation, i n’est pas un taux d’intérêt ; il n’y a pas de monnaie dans ce modèle)
Le principe de responsabilité à l’équilibre
Les conditions d’équilibre sont nécessaires mais non suffisantes pour que le principe de responsabilité soit respecté. En effet, elles ne disent rien de la manière dont les capitaux neufs fabriqués par les entrepreneurs sont effectivement répartis entre les ménages qui avaient demandé de la marchandise « imaginaire » E. Cette distribution ne peut se faire que dans la « période de livraisons réciproques de services et de produits » qui suit l’équilibre.
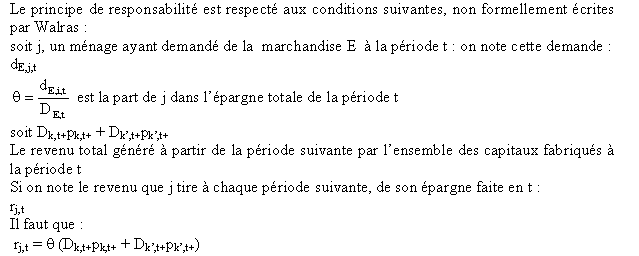
C’est à dire qu’il faut que le revenu de chaque capitaliste à chacune des périodes futures, soit proportionnel à son effort d’épargne à la période présente.
On voit que, si cette condition est respectée, quelle que soit l’évolution future des prix de location des tracteurs et des camions de déménagement, le principe de responsabilité sera respecté pour l’infini des temps. Celui qui a acheté en t, deux fois plus de E que son voisin, pour un prix deux fois supérieur, recevra à chaque période, un revenu deux fois plus élevé. La fable « la cigale et la fourmi » peut donc être justement présentée, comme une métaphore de ce capitalisme là.
On verra au prochain chapitre, par quel mécanisme les capitaux neufs doivent être distribués entre les ménages pour remplir cette condition ‘morale’.
Hayek et la résolution du conflit entre responsabilité et idéal social.
Le principe de responsabilité est une valeur partagée par de nombreux économistes et philosophes. Rawls écrit par exemple « Le principe de liberté conduit au principe de responsabilité »(TJp278).
Comment les successeurs de Walras résolvent ils le dilemme entre responsabilité et échange juste ?
Rappelons que l’on a identifié deux entorses à la responsabilité dans la société marchande :
- la première, que Walras semble répugner à admettre, est celle qui découle de la formation des prix qui fait retomber sur chacun les offres et les demandes de tous.
- la seconde est celle qui résulte de la diversité des anticipations des prix des capitaux.
La seconde est ‘résolue’ dans la théorie moderne de l’équilibre général, par les marchés à terme et l’assurance.
La première en revanche, est inhérente au fonctionnement du marché : si j’offre mon travail sur le marché, je diminue le salaire des autres travailleurs, sans que ceux ci en soient aucunement responsables. Les économistes doivent ils donc renoncer au principe de responsabilité ? Et au fait, pourquoi sont ils partisans de ce principe ? Il nous semble qu’une citation de Hayek éclaire ces questions.
Pour Hayek, le « jeu de la catallaxie », ne peut évidemment pas récompenser les individus selon leurs ‘mérites’. Pour Hayek, ce principe est à rejeter, comme tout principe distributif.
« Comme dans un jeu, alors que nous insistons à bon droit qu’il soit loyal et que personne ne triche, il serait absurde de demander que les résultats pour chaque joueur soient justes. Il seront déterminés en partie par le talent et en partie par la chance » (DLL,T2p86).
Néanmoins, Hayek est tout à fait d’accord pour que le principe de responsabilité soit diffusé dans le public :
« Il est certainement important dans l’ordre de marché, que les individus pensent que leur bien être dépend primordialement de leurs propres efforts et décisions. A vrai dire, il n’est guère de circonstance plus capable de rendre quelqu’un énergique et efficace, que la pensée qu’il dépend principalement de lui, qu’il parvienne aux buts qu’il s’était assignés. C’est pour cela que cette croyance est encouragée par l’éducation et par l’opinion dominante, et, à ce me semble, pour le plus grand bien de la plupart des membres de la société, qui sont redevables de nombreux progrès matériels et moraux, à des personnes qu’anime cette idée.(DLLT2p89)
Il nous semble que Hayek a bien vu que le principe de responsabilité avait deux dimensions :
- une dimension volontaire : l’individu i veut influer sur le sort de l’individu j
- une dimension involontaire : i peut, sans le vouloir influer sur le sort de j
Si le projet des économistes est de faire réaliser le bien public par des individus qui ne le recherchent pas, peu importe que les individus influent involontairement les uns sur les autres : ce qui est mal, c’est que les individus influent volontairement les uns sur les autres. Hayek nous semble donc ici plus cohérent que Walras.
conclusion
Il nous semble que l’opinion de Walras en ce qui concerne la responsabilité individuelle préfigure une idée de Hayek que l’on présentera dans le chapitre 6 : Un des objectifs de l’éthique sociale déterminée par les économistes est en fait un objectif d’éthique individuelle, une éthique qui, en un mot comme en cent, prescrit aux agents de s’intéresser à leurs propres affaires, et non aux affaires publiques.
§ § § § § § § § § § § § § § § § § §
Digression : Les agents peuvent-il être paretiens ?
On a dit précédemment que les économistes ne faisaient pas de propagande en faveur de leurs définition du bien public. Cependant, les recherches sur l’économie « kantienne » semblent indiquer une tentation dans ce sens à Propos de l’optimum de Pareto. Or, si il semble logiquement possible d’imaginer que des agents puissent être convertis à l’utilitarisme (si les utilités peuvent être comparés), à l’idée de la justice dans l’échange, ou au maximin, il nous semble plus difficile de concevoir des agents consciemment paretiens.
Peut-on imaginer des agents paretiens, quand la norme retenue par l’économiste est elle-même l’optimum de Pareto ?
Dans la lignée de la proposition kantienne de Laffont (1975) , A.Wolfelsperger (1999) (2001) a proposé une réinterprétation éthique du paretianisme.
Dans « Comment peut-on être paretien ? » (2001), il critique le paretianisme ‘ordinaire’, et suggère qu’il serait bon que les agents soient paretiens.
Il remarque que les modèles d’économie normative décrivent presque toujours les actions d’individus ‘autocentrés’ sous le regard d’un observateur paretien :
« … dans les exposés classiques de l’économie du bien être, c’est seulement à l’Etat qu’il est demandé de se comporter conformément aux préceptes paretiens par le biais des actions imposées aux agents. Les évaluations et les prescriptions paretiennes sont de la compétence exclusive de l’Etat. P’13a’« [pour] l’économie publique orthodoxe… l’Etat garde son statut théorique privilégié par rapport aux agents « ordinaires »p’13b’.
« Il est intéressant d’observer qu’il n’est venu à l’esprit d’aucun paretien de préconiser l’adhésion à une morale paretienne de la part des agents concernés eux-mêmes… Cette morale, en présence d’un bien collectif donnant naissance à un dilemme du prisonnier classique, conduirait pourtant chaque individu à choisir la stratégie de coopération, parce que c’est ce qu’exige dans ce cas, l’objectif d’atteindre la situation optimale au sens de Pareto ».p’13b’
On tente d’illustrer ce raisonnement au pied de la lettre et d’imaginer ce qui se passe si les agents sont eux aussi paretiens.
La première question qui se pose est la suivante : le ‘paretianisme’ des agents se reflète t’il dans leurs fonctions de préférences ? L’auteur ne semble pas trancher explicitement cette question. Il écrit « lorsqu’il porte des jugements de valeur, l’économiste ne peut faire autrement que de se référer au système complet de préférence des agents sur leurs actions de toute nature »p’9a’(en italiques chez l’auteur). Mais il présente ensuite un exemple qu’il tire d’un célèbre texte du philosophe Emmanuel Kant, et il conclut « Jean adhère entièrement et exclusivement à la morale paretienne » laissant entendre que son paretianisme est une morale de l’action indifférente aux résultats. On considèrera donc successivement les cas suivants :
Paretianisme conséquentialiste : l’ agent est paretien parce qu’il veut le ‘bon résultat’ (comme l’observateur) et ce paretianisme est donc inclus dans les préférences.
Paretianisme déontologique : l’agent est paretien par obéissance à une loi morale, sans égard pour les conséquences (comme dans le modèle de JJ.Laffont ), et ce ‘paretianisme’ ne modifie pas ses préférences.
Le paretianisme conséquentialiste
Reprenons donc le modèle du « dilemme du prisonnier ». Comme la norme paretienne est souvent associée à l’idée de préférences ordinales, remplaçons les chiffres de tout à l’heure par des lettres. Dans le cas ou les agents ont des préférences purement ‘autocentrées’, la matrice des gains est :
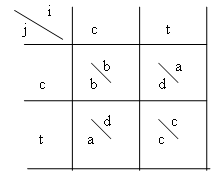
i préfère a à b, b à c, et c à d. Il en est de même pour j.
On se limitera aux deux cas polaires : des agents purement ‘autocentrés’ et des agents absolument ‘paretiens’.
Imaginons d’abord que i est paretien, et qu’il pense (à tort ou à raison) que j est ‘autocentré.
i, le paretien, juge alors indifféremment, les trois issues paretiennes, et la matrice devient alors :

Mais l’histoire n’est pas finie : Compte tenu des préférences purement paretiennes de i, il n’y a plus désormais qu’une issue paretienne : celle ou i coopère, et ou j trahit, et i s’en aperçoit. D’où :
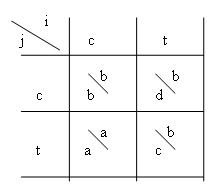
L’issue coopère/coopère, n’est plus optimale. L’agent qui a des préférences paretiennes préfère donc l’issue qui lui serait la plus défavorable s’il était ‘autocentré’. Coopérer est pour lui une stratégie dominante, mais parce qu’il pense que j trahira.. D’une manière générale, l’agent paretien i choisira le résultat le plus favorable à j. Si i et j doivent se partager un gâteau, le partage optimal et celui que préfèrera le paretien i, sera le partage ou j a tout et i rien.
Si, alternativement, les deux agents sont paretiens et savent que l’autre l’est, la matrice devient :
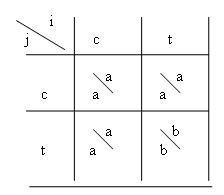
L’issue coopère/coopère reste optimale, et elle est atteinte parce que la stratégie ‘toujours coopérer’ est dominante. Mais les deux agents se porteraient aussi bien si l’un coopérait et si l’autre trahissait, et si les deux agents se retrouvent libres, c’est parce que cela leur est égal de rester en prison pourvu que l’autre soit libre ou inversement.
Dans le cas du partage du gâteau, les deux agents paretiens sont pareillement indifférents. Chacun des deux se trouve aussi bien à avoir tout le gâteau que rien. Le partage sera donc toujours optimal.
D’une manière générale, l’idée d’agents paretiens conséquentialistes nous semble dissoudre la situation même qu’il s’agit de juger.
Le paretianisme déontologique
L’agent paretien i obéit à une loi morale qui lui est extérieure. Quoi qu’il arrive, la matrice des gains reste celle des agents ‘autocentrés’.
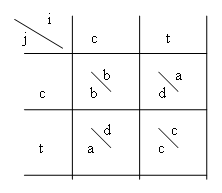
Maintenant, quelle action doit choisir i, le paretien moral ? Il doit toujours coopérer, comme le fait remarquer A.Wolfelsperger car c’est la règle qui assurera qu’une issue optimale sera atteinte, que j coopère ou pas. Dans la production d’un bien public, la règle d’action du paretien moral est donc : toujours coopérer.
Dans le cas du partage du gâteau en revanche, la morale paretienne n’est plus un guide suffisant pour l’action, mais ceci n’est dû qu’à la pluralité des partages optimaux. L’agent dont les préférences sont restées ‘autocentrées’ peut, par exemple prendre tout le gâteau pour lui.
Le paretianisme déontologique de l’agent, est donc, contrairement au paretianisme conséquentialiste, à la fois cohérent et ‘efficace’.
Mais, nous souhaitons faire remarquer le sens politique de ce paretianisme moral : Si l’agent est un paretien moral, c’est à dire s’il suit une règle d’action, il ne veut plus le bien public, au contraire de l’observateur.
Or pourquoi les économistes sont-ils paretiens ? Parce qu’ils pensent que cela vaut la peine de changer pour une situation qui améliore la situation de tous. Autrement dit, le paretianisme de l’observateur est un conséquentialisme : il tire sa valeur de son résultat. Au contraire, le paretianisme moral de l’agent ne recherche que l’obéissance à la règle.
A cet égard, on peut relire une phrase d’ A.Wolfelsperger déjà citée :
« Il est intéressant d’observer qu’il n’est venu à l’esprit d’aucun paretien de préconiser l’adhésion à une morale paretienne de la part des agents concernés eux-mêmes »
Dans cette phrase, nous avons « le paretien » sans phrase, que l’on peut supposer être l’économiste ou l’Etat, et « les agents concernés » qui sont les agents ‘en situation’ (par exemple dans le dilemme du prisonnier). L’auteur propose donc que l’économiste/l’Etat « préconise » aux agents « l’adhésion à une morale paretienne ». Il nous semble que, contrairement à ce que le texte laisse penser, cette proposition ne change rien à l’asymétrie que Wolfelsperger remarque chez les « orthodoxes » entre l’économiste/l’Etat et les agents.
-d’abord, parce que « le paretien » convertit « les agents » à la norme de bien public qu’il a auparavant déterminée.
- et ensuite et surtout, parce que, comme on vient de le dire, l’observateur et les agents continuent à ne pas vouloir la même chose.
- l’observateur conséquentialiste veut le bien public.
- les agents déontologiques veulent obéir à la règle.
La morale paretienne est donc l’instrument de l’observateur, qui la « préconise », en vue d’atteindre le bien public (paretien) qui n’intéresse toujours pas les agents.
conclusion
Si le but à atteindre est l’optimum de Pareto, alors les individus doivent vouloir par principe toujours coopérer, plutôt que de rechercher l’optimum lui-même.
Conclusion
On a pu remarquer dans ce chapitre que l’idée d’individus parvenant à réaliser le bien public sans l’avoir cherché contenait plus qu’elle-même. En effet, l’économiste utilise déjà des individus ‘autocentrés’, pour déterminer le bien public, toujours (déjà) sans le rechercher. Et la distribution finale qui réalise le bien public doit réaliser aussi une éthique de responsabilité individuelle qui se résume finalement à l’idée qu’ils ne doivent pas rechercher le bien public.
Il nous semble que cette extension de l’économisme à la détermination du bien public est une nouveauté de la ‘révolution’ néoclassique. En effet, le bien être du travailleur britannique ‘vivant mieux que mille indiens nus’ d’Adam Smith, la règle communiste « à chacun selon ses besoins » de Marx n’ont pas besoin d’une parabole mettant en scène des individus indifférents les uns aux autres pour être déterminés. Les avantages de l’intérêt personnel sont encore uniquement instrumentaux. Ce n’est plus le cas chez Walras et Pareto (et leurs successeurs, économistes ou philosophes). Il nous semble que c’est parce que la critique du paternalisme et la défense de la ‘liberté des modernes’ sont devenus des objectifs fondamentaux des théoriciens.